-
L'anecdote suivante souligne le manque de notoriété, ou pour certains, le manque d'intérêt de la ville : des étudiants de l'université de Kiel ont commencé à soupçonner en 1994 que la ville de Bielefeld n'existait pas. En effet, elle ne faisait pas beaucoup parler d'elle et ils étaient persuadés que pour diverses raisons, une grande conspiration avait été organisée pour faire croire à l'existence de la ville, en particulier la création d'un site web factice de la municipalité, et le recrutement d'acteurs pour constituer une équipe de football...
Liens externes
* Le premier post à ce sujet dans un newsgroup Google (en allemand)
* Un article détaillé sur le sujet (en anglais)
* L'article wikipedia en anglaisOn prétend aussi sur internet que la Belgique n'existe pas... (cf. l'article en anglais : http://zapatopi.net/belgium/)
 votre commentaire
votre commentaire
-

Reflète tout à fait le non-sens, expression qui se dit en yiddish a nakhtiger tog (un jour nocturne).
 votre commentaire
votre commentaire
-
Marcel Moreau - Monstre
Je me souviens d'immolations grossières
"Ma sensibilité à l'état brut, aidés de noires énergies mystiques, moins promptes à parler de l'éternel qu'à éterniser le Verbe, c'est par elle que je fis œuvre inactuelle, en ce monde si français, du divorcé d'avec lui-même. Oeuvre rythmée de magies, de fascination, de transes, de remous biologiques aussi ardents que la foi des anciens, créatrice d'une seule idole en ses métamorphoses : l'écriture comme un défi aux idoles d'aujourd'hui, tout ce que vous aimez, gens sans âme, excréments du passé et déjà de l'avenir."
source : http://membres.lycos.fr/arachnid/monstre.html votre commentaire
votre commentaire
-
-
William Penn - et toutes cérémonies extérieures finirent en lui et par lui qui était la réalité même
Il se montre alors de plus près qu'autrefois, car suivant sa promesse il écrira sa loi dans notre coeur, et nous donnera sa crainte et son esprit au dedans de nous. Dès lors les signes, les images et les emblêmes disparurent ; la lumière qui commençait à lui, ayant fait voir leur peu d'efficacité à purifier la conscience, puisqu'ils ne pouvaient atteindre à l'intérieur du vase, et toutes cérémonies extérieures finirent en lui et par lui qui était la réalité même.
William Penn, Histoire abrégée de l'origine et de la formation de la société dite des Quakers (1839), p.7
source : Google Books votre commentaire
votre commentaire
-
La première [lettre] me vient d’une femme qui, si j’en juge par les sentiments qu’elle exprime, est un grand coeur. Elle administre une des crèches municipales de Paris, « non par vanité, dit-elle, non pour voir mon nom imprimé dans les rapports et les journaux, non par désoeuvrement, comme tant d’autres, mais poussée par le très grand amour que j’ai pour les petits, et par les soucis de mes devoirs de solidarité humaine » – car elle croit à la solidarité humaine, cette rêveuse !... Dans la mission difficile qu’elle a acceptée, elle fait ce qu’elle peut, tout ce qu’elle peut, plus qu’elle ne peut. Et, bien que les ressources dont elle dispose soient très maigres, bien qu’elle se trouve, sans cesse, arrêtée par des règlements barbares autant qu’idiots, contre lesquels se brisent souvent son intelligence et son énergie, elle s’en tire à peu près... Grâce à des soins persistants, à une surveillance de toutes les minutes, à une ingéniosité, une initiative, qui savent quelquefois suppléer aux étranges lacunes du règlement, et tourner les obstacles administratifs, les petits s’élèvent, grandissent. On va peut-être les sauver... Eh bien, non !... Toute cette bonne volonté, tout ce mal, toute cette abnégation tout ce génie de la tendresse et de l’amour deviennent inutiles devant une épidémie de rougeole, par exemple. Et Paris voit revenir cette épidémie, périodiquement, dans le premier trimestre de chaque année. Or ce n’est pas de l’épidémie qu’ils meurent, les pauvres enfants, mais de quelque chose de bien plus mortel que les plus mortelles maladies du règlement !
Chaque semaine, M. Bertillon, statisticien précis et illusoire, nous apprend le nombre des décès causés par le fièvre typhoïde, la tuberculose, la scarlatine, la diphtérie, la rougeole, la variole etc. De l’administration qui dépeuple et du règlement qui tue, il ne nous dit jamais un mot... Et pourtant, il n’est pas de choléra, de peste, de fièvre infectieuse, qui fassent autant de victimes, surtout parmi les tout jeunes. Aussitôt que l’épidémie de rougeole, avec une régularité en quelque sorte mathématique, se produit à Paris, ordre est donné de fermer les crèches, soi-disant pour préserver les enfants d’une contagion immédiate. Les mères sont invitées à aller chercher leurs enfants et à les conduire à l’hôpital. Car la société est admirable : elle a de tout, des crèches, des asiles, des hôpitaux... Mais, à l’hôpital, le nombre de lits est toujours insuffisant, et puis un enfant, guéri d’une maladie, risque d’en attraper une autre. Au bout de huit à dix jours, vite, on le renvoie, alors que trois semaines de soins attentifs et de surveillance sévère seraient indispensable pour assurer une guérison complète, et surtout pour éviter les rechutes, qui sont presque toujours mortelles... On le renvoie donc. Où peut-il aller ? La crèche est fermée. Force est bien à la mère de ramener le petit de l’hôpital chez elle... Et comme elle doit travailler pour vivre – car le plus souvent le père manque, ou il boit – elle donne son enfant en garde, soit à la concierge, soit à une voisine; ou bien elle le laisse aux soins capricieux d’un enfant plus âgé. Alors le pauvre petit être, mal couvert, mal nourri, exposé aux courants d’air d’une chambre mal close et sans feu, succombe en quelques jours aux inévitables atteintes de la pneumonie. C’est ainsi qu’en 1899, sur trente-deux enfants, cette crèche dont je parle et qui, par exception, est une crèche admirablement tenue, n’en a vu revenir que quinze à la réouverture. Dix-sept étaient morts !...
Extrait d’un article d’Octave Mirbeau,
dans Le Journal, du 2 décembre 1900
(source : www.scribd.com) votre commentaire
votre commentaire
-
Je pense, donc je suis. Toutes les autres choses que la pensée, tout le reste de l'univers, existent sans moi et je ne puis savoir si leur existence est réalité, illusion ou rêve. Mais je sais qu'une chose est certaine parce que je lui donne moi-même une existence certaine : ma pensée.
Rudolf Steiner, La Philosophie de la liberté, 1918 (p.48-49)
source : Gallica votre commentaire
votre commentaire
-
-
de Stéphane Goldman
une chanson écrire
sur la seule partie de l'homme
soluble dans l'alcool :
La Conscience
Dans une pièce, sur une table, attendait
Une bouteille, une bouteille
Dans une pièce, sur une table, attendait
Une bouteille pleine de beaujolais
Un homme entra, que l'alcool séduisait
Et sa langue, et sa langue
Un homme entra, que l'alcool séduisait
Et sa langue sur le côté pendait
Pendé penda pendi pendi pendé
Sa conscience, sa conscience
Pendé penda pendi pendi pendé
Sa conscience alors lui a parlé
"Soit plus fort que la tentation"
Lui dit-elle, lui dit-elle
"Soit plus fort que la tentation
"Vas boire de l'eau, crois-moi c'est aussi beau"
Hallelujah, car le vice a perdu
Et notre homme, et notre homme
Hallelujah, car le vice a perdu
Et notre homme, pour ce coup, n'a pas bu
En titubant, à son tour, disparaît,
La conscience, la conscience
En titubant, à son tour, disparaît,
La conscience pleine de beaujolais
Dans la pièce, sur la table, n'attend plus
La bouteille, la bouteille,
Dans la pièce, sur la table, n'attend plus
La bouteille que la conscience a bu. votre commentaire
votre commentaire
-
Lorsque j'étais dans la ville de Bénarès sur le rivage du Gange, ancienne patrie des bracmanes, je tâchai de m'instruire. J'entendais passablement l'indien; j'écoutais beaucoup et remarquais tout. J'étais logé chez mon correspondant Omri; c'était le plus digne homme que j'aie jamais connu. Il était de la religion des bramins, j'ai l'honneur d'être musulman : jamais nous n'avons eu une parole plus haute que l'autre au sujet de Mahomet et de Brahma. Nous faisions nos ablutions chacun de notre côté; nous buvions de la même limonade, nous mangions du même riz, comme deux frères.
Un jour, nous allâmes ensemble à la pagode de Gavani. Nous y vîmes plusieurs bandes de fakirs, dont les uns étaient des janguis, c'est-à-dire des fakirs contemplatifs, et les autres des disciples des anciens gymnosophistes, qui menaient une vie active. Ils ont, comme on sait, une langue savante, qui est celle des plus anciens bracmanes, et, dans cette langue, un livre qu'ils appellent le Veidam. C'est assurément le plus ancien livre de toute l'Asie, sans en excepter le Zend-Avesta.
Je passai devant un fakir qui lisait ce livre. "Ah! malheureux infidèle! s'écria-t-il, tu m'as fait perdre le nombre des voyelles que je comptais; et, de cette affaire-là, mon âme passera dans le corps d'un lièvre au lieu d'aller dans celui d'un perroquet, comme j'avais tout lieu de m'en flatter." Je lui donnai une roupie pour le consoler. A quelques pas de là, ayant eu le malheur d'éternuer, le bruit que je fis réveilla un fakir qui était en extase. "Où suis-je? dit-il. Quelle horrible chute! je ne vois plus le bout de mon nez : la lumière céleste est disparue. - Si je suis cause, lui dis-je, que vous voyez enfin plus loin que le bout de votre nez, voilà une roupie pour réparer le mal que j'ai fait; reprenez votre lumière céleste."
M'étant ainsi tiré d'affaire discrètement, je passai aux autres gymnosophistes : il y en eut plusieurs qui m'apportèrent de petits clous fort jolis, pour m'enfoncer dans les bras et dans les cuisses en l'honneur de Brahma. J'achetai leurs clous, dont j'ai fait clouer mes tapis. D'autres dansaient sur les mains; d'autres voltigeaient sur la corde lâche; d'autres allaient toujours à cloche-pied. Il y en avait qui portaient des chaînes, d'autres un bât; quelques-uns avaient leur tête dans un boisseau : au demeurant les meilleures gens du monde. Mon ami Omri me mena dans la cellule d'un des plus fameux; il s'appelait Bababec : il était nu comme un singe, et avait au cou une grosse chaîne qui pesait plus de soixante livres. Il était assis sur une chaise de bois, proprement garnie de petites pointes de clous qui lui entraient dans les fesses, et on aurait cru qu'il était sur un lit de satin. Beaucoup de femmes venaient le consulter; il était l'oracle des familles; et on peut dire qu'il jouissait d'une très grande réputation. Je fus témoin du long entretien qu'Omri eut avec lui. "Croyez-vous, lui dit-il, mon père, qu'après avoir passé par l'épreuve des sept métempsycoses, je puisse parvenir à la demeure de Brahma? - C'est selon, dit le fakir; comment vivez-vous? - Je tâche, dit Omri, d'être bon citoyen, bon mari, bon père, bon ami; je prête de l'argent sans intérêt aux riches dans l'occasion; j'en donne aux pauvres; j'entretiens la paix parmi mes voisins. - Vous mettez-vous quelquefois des clous dans le cul? demanda le bramin. - Jamais, mon révérend père. - J'en suis fâché, répliqua le fakir : vous n'irez certainement que dans le dix-neuvième ciel; et c'est dommage. - Comment! dit Omri, cela est fort honnête; je suis très content de mon lot : que m'importe du dix-neuvième ou du vingtième, pourvu que je fasse mon devoir dans mon pèlerinage, et que je sois bien reçu au dernier gîte? N'est-ce pas assez d'être honnête homme dans ce pays-ci, et d'être ensuite heureux au pays de Brahma? Dans quel ciel prétendez-vous donc aller, vous, monsieur Bababec, avec vos clous et vos chaînes? - Dans le trente-cinquième, dit Bababec. - Je vous trouve plaisant, répliqua Omri, de prétendre être logé plus haut que moi : ce ne peut être assurément que l'effet d'une excessive ambition. Vous condamnez ceux qui recherchent les honneurs dans cette vie, pourquoi en voulez-vous de si grands dans l'autre? Et sur quoi d'ailleurs prétendez-vous être mieux traité que moi? Sachez que je donne plus en aumônes en dix jours que ne vous coûtent en dix ans tous les clous que vous vous enfoncez dans le derrière. Brahma a bien à faire que vous passiez la journée tout nu, avec une chaîne au cou; vous rendez là un beau service à la patrie. Je fais cent fois plus de cas d'un homme qui sème des légumes, ou qui plante des arbres, que de tous vos camarades qui regardent le bout de leur nez ou qui portent un bât par excès de noblesse d'âme." Ayant parlé ainsi, Omri se radoucit, le caressa, le persuada, l'engagea enfin à laisser là ses clous et sa chaîne et à venir chez lui mener une vie honnête. On le décrassa, on le frotta d'essences parfumées, on l'habilla décemment; il vécut quinze jours d'une manière fort sage, et avoua qu'il était cent fois plus heureux qu'auparavant. Mais il perdait son crédit dans le peuple; les femmes ne venaient plus le consulter; il quitta Omri, et reprit ses clous, pour avoir de la considération.
Voltaire, Lettre d'un Turc sur les fakirs et sur son ami Bababec, 1750
source : Wikisource votre commentaire
votre commentaire
-
Nasreddin Hodja, à sa manière, choisit entre rêve et réalité. Son fils lui dit un jour :
- Cette nuit, j'ai rêvé que tu me donnais cent dinars.
- C'est parfait, lui dit son père. Comme tu es un enfant très sage, tu peux garder ces cents dinars. Achète-toi ce que tu voudras.
Jean-Claude Carrière, Le cercle des menteurs, Contes philosophiques du monde entier
France Loisirs, Paris, 1998 (p.75) votre commentaire
votre commentaire
-
-
Quant à croire qu'un autre est responsable de nos défaillances, c'est une erreur. Elles sont un témoignage de notre faiblesse et ceux qui nous tentent, plus ou moins inconsciemment, nous rendent le service de nous la révéler.
La Révélation, La solidarité, p.104
 votre commentaire
votre commentaire
-
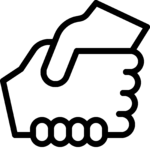
La personne qui nous aide, si elle n'est pas Dieu, Le représente ; elle a droit à notre amour et à notre respect.
La Révélation, La solidarité, p.103
 votre commentaire
votre commentaire
-

Une œuvre n'est jamais personnelle ; celle que vous m'attribuez est donc collective, d'autant plus qu'on ne peut faire son bonheur que du bonheur des autres. Tous indistinctement sont appelés à en jouir, en vertu de la solidarité, nous ne formons ensemble qu'une grande famille.
La Révélation, La solidarité, p.102
 votre commentaire
votre commentaire
-
La vérité n'est pour nous que relative et non absolue ; répétons-le : nous construisons aujourd'hui pour démolir demain, puis nous reconstruisons avec des éléments plus rationnels.
La Révélation, Être ou paraître, p.74
 votre commentaire
votre commentaire
-
Il faut agir sans crainte ; toute gêne est une faiblesse qui nous abîme et que nous devons surmonter. Si tout homme osait dire franchement et hautement ce qu'il pense, il serait toujours dans la réalité. Combien nous nous rendons malheureux en voulant cacher notre nature ! Ne craignons rien ni personne, si ce n'est nous-mêmes, notre faiblesse.
La Révélation, Être ou paraître, p.71
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
sur les traces d'un homme d'exception et de son universalisme philosophique...............Musée virtuel de l'Antoinisme









