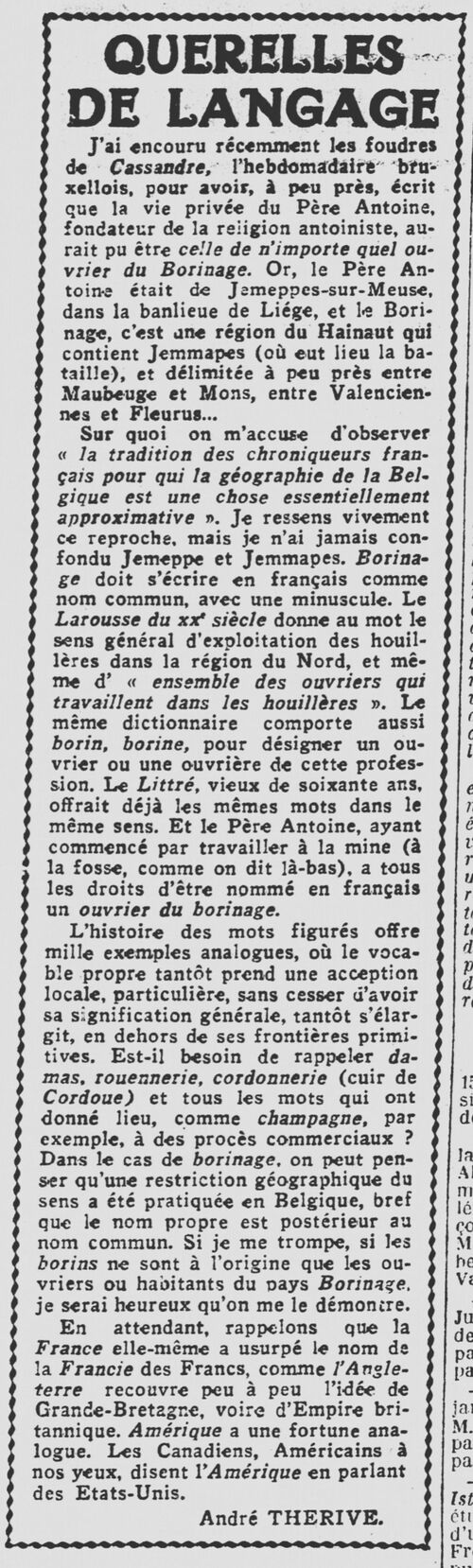-
André Thérive - Sans âme (1928)
André Thérive, de son vrai nom Roger Puthoste, né le 19 juin 1891 à Limoges, mort le 4 juin 1967 à Paris, est un écrivain, romancier, journaliste et critique littéraire français.
Sous les drapeaux lorsque la guerre de 1914 éclate, il est plusieurs fois blessé. Il est nommé caporal le 9 mars, puis sergent-fourrier (2 décembre 1915) enfin sergent-major (17 janvier 1917) dans une compagnie de mitrailleuses. Son courage lui vaudra d’être décoré de la Croix de guerre et de la Médaille militaire.
Proche des Croix de feu (il collabore à l’organe de ce mouvement d'anciens combattants français de la Grande Guerre qui se transforme ensuite en organisation politique nationaliste avant d'être dissout en 1936), il fonde avec Léon Lemonnier l’école dite « populiste » qu’il définit comme un retour du roman « à la peinture de classe, à l’étude des problèmes sociaux. »
Hormis plusieurs révits de guerre, il publie Sans âme, chez Grasset (coll. « Les écrits »), en 1928. Il y décrit les pérégrinations et les amours de Julien à Paris en 1934. Avec une description des milieux spiritualistes (antoinisme, occultisme) et du music-hall. La même année, il écrit un article sur le mouvement dans Le Journal. Une édition illustrée de Sans âme par Germaine Estival est publiée en 1933 chez Ferenczi, Collection Le Livre moderne illustré.
Il écrit également sur J.-K. Huysmans et son œuvre, et sur Clotilde de Vaux (ou La déesse morte, Albin Michel, 1957), femme qui inspira à Auguste Comte la « Religion de l'Humanité ». Si le positivisme n'était que la doctrine d'une secte philosophique, nous n'aurions, en effet, que peu de goût à le choisir ici pour propos. Mais c'est un roman, très véritable, qui donna chair et sang à ce système, et qui en fit une religion. (p. 12).
Il publie Les portes de l'Enfer chez Bloud et Gay en 1925 et Entours de la foi, chez Grasset en 1966.
illustration : Le populisme au cinéma (Cinémonde, n° 75, 27 mars 1930)
source : bibliotheques-specialisees.paris.fr -
Par antoiniste le 30 Juin 2023 à 11:33
L'ANTOINISME DANS LE ROMAN
Dans « La Vie wallonne » (12, rue Saint- Mathieu, Liége), M. Pierre Landelies, à propos d'un livre : « Sans Ame », publié naguère par M. André Thérive, parle de l'antoinisme dans le roman :
Religion éclose sur les coteaux de Meuse, à quelques kilomètres de la Cité, l'antoinisme porte en soi les marques du paysage qui l'a vu naître. A la douceur des ciels gris appuyés sur les collines roses succèdent les nuits traversées des lueurs ardentes et cyclopéennes des hauts fourneaux au travail : étrange union des contraires, spiritualité et matière mêlant leur rythme en un perpétuel acte de foi pour créer la vie. Ainsi l'antoinisme : religion de foi simple et fruste, sans grand apparat, entourée d'une spiritualité assez vague et informe pour plaire aux humbles et les conquérir. Religion touchant à la lumière en la niant. Il serait assez curieux de rechercher ce que l'antoinisme doit aux autres religions et philosophies, depuis Epictete jusqu'à Allan Kardec, amalgame d'idées hétéroclites et parfois contradictoires. Il serait plus intéressant encore de suivre, dans la foule souffrante à qui il s'adresse, son influence ascendante.
Le Soir, 27 juin 1932
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 5 Décembre 2022 à 18:17
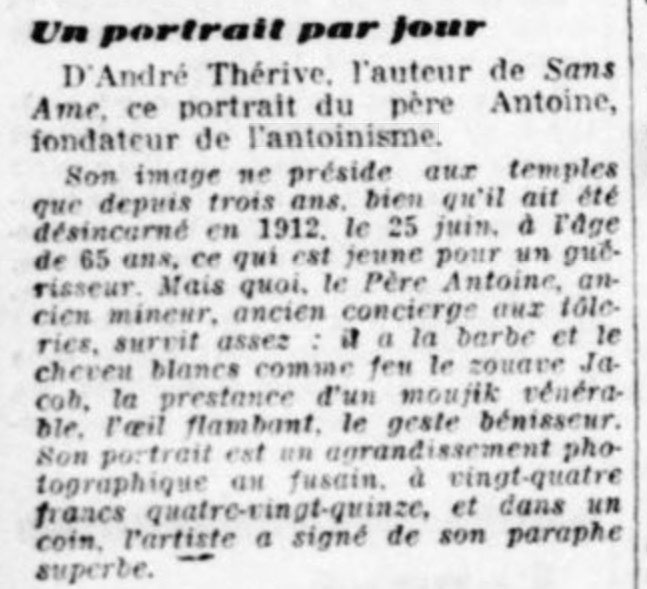
Un portrait par jour
D'André Thérive, l'auteur de Sans Ame, ce portrait du père Antoine, fondateur de l'antoinisme.
Son image ne préside aux temples que depuis trois ans, bien qu'il ait été désincarné en 1912, le 25 juin, à l'âge de 65 ans, ce qui est jeune pour un guérisseur. Mais quoi, le Père Antoine, ancien mineur, ancien concierge aux tôleries, survit assez : il a la barbe et le cheveu blancs comme feu le zouave Jacob, la prestance d'un moujik vénérable, l’œil flambant, le geste bénisseur. Son portrait est un agrandissement photographique an fusain, à vingt-quatre francs quatre-vingt-quinze, et dans un coin, l'artiste a signé de son paraphe superbe.Le Nouveau siècle, 21 février 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 9 Juin 2022 à 10:11
BONNES FEUILLES
Sans âme... Sans âme, par André Therive (Grasset, éditeur). Est-ce Huysmans, est-ce Tolstoï qu'il faut rappeler à propos de l'histoire de Julien Lepers, de l'ouvrière Lucette, de la danseuses Lydia ? et de tant d'autres personnages inoubliables ?
III
Le train avait passé Thieulecques ; avant d'arriver à la station de Saint-Achille, Julien aperçut, fort près de la voie, la sucrerie rouge de M. Drémoncourt, son oncle. Les bâtiments, la haute cheminée, la villa, tout flambait neuf, au milieu des champs pâles et sur un fond de bois dépouillés. Tout cela avait été dévasté par la guerre, reconstruit magnifiquement sur les toits éclatants, un jeu de tuiles faisait lire le nom de Ghislain Drémoncourt beaucoup plus fièrement qu'un drapeau.
Le maître de ces lieux vint chercher son neveu à la gare. Il avait notablement vieilli depuis un an ; enflé, tassé, les yeux sanglants, mais la parole gaillarde. Sous des dehors si grossiers, c'était un esprit vif et curieux. Ancien pharmacien à Saint-Omer, où la société bien pensante lui rendit autrefois la vie intenable, on le disait prospère dans l'industrie, et sa vieillesse semblait son apogée. Mais il ne parlait pas de ses affaires. Deux passions fortes l'animaient encore : l'une politique et qui se devine ; l'autre d'exceller à la tapisserie. Il s'était brodé lui-même des pantoufles historiées, tantôt à ses initiales gothiques, tantôt au caducée ou au mortier de son ancienne confrérie. Il avait été marié, veuf de très bonne heure, coureur assez longtemps. A présent, il se contentait de son industrie et d'intrigues politiques, qui lui faisaient trouver dans les journaux une pâture savoureuse et variée. Il n'était même pas conseiller général ; il était faiseur de députés comme on fut faiseur de rois, en dédaignant un peu ses créatures. Bien moins riche d'ailleurs que son renom ne le voulait ; satisfait de faire peur à ses ennemis, envie à ses amis, et en cela de duper tout le monde à moitié. Gourmet à la mode d'aujourd'hui, gourmand aussi à la mode d'hier. Casanier depuis deux ou trois ans, il avouait avec amertume, au moins dans ses lettres, qu'il est sage de se détacher de la vie quand elle se détache de vous. Mais, en paroles, une pudeur le gardait de cette forfanterie plaintive.
– Alors, il y a eu un drame demanda Julien, copieusement embrassé.
– Oui, oui, je te raconterai. Mais, d'abord, que je te prévienne : il va nous arriver de Wazemmes les de Gouin pour déjeuner, après la messe. Deux parents, trois filles. Je me suis réconcilié par lettre avec eux ; ou eux avec moi. Enfin, mettons tous ensemble. Il n'y a pas tant d'occasions de faire la fête en famille. Autant ceux-là que d'autres ; ils habitent si près ! Vois-tu, il n'y a rien de si terrible que la solitude. Il me semble que je la sens plus lourde de mois en mois. J'ai bien le temps, que diable, d'être enterré pour de bon !
Ces paroles, dites avec gaité, rendaient un son funèbre. L'air était aigre, glacé par moments. La boue de novembre ne séchait plus sur les routes où les camions marquaient leurs ornières pour six mois. Au bord des champs, des silos à betteraves, voutés comme des tombeaux, exhalaient, malgré le froid, une puanteur acide.
– Ah ! Dieu de Dieu ! s'écria encore M. Drémoncourt, que j'aime à te voir, Julien, froncer le nez devant l'odeur de la campagne maternelle ! Les de Gouin, au moins, sont des rustiques : ils ont fait de la terre, de la vie aux champs, un article de foi ; cela en ajoute un à ceux qu'ils croient déjà. On n'en saurait trop mettre. J'espère bien que tu les feras enrager là-dessus. Car il est inutile de parader devant ces demoiselles : tu as surement horreur de la campagne et de ton oncle campagnard.
Il frappa amicalement sur l'épaule du neveu, qui lui prit le bras et avoua :
– Ce qui doit être affreux dans la campagne, c'est de pouvoir penser à soi trop nettement, et de voir toute simple, toute fatale devant soi, sa destinée.
– Tu me dis ça, fit observer M. Drémoncourt, souriant, à moi qui la verrais n'importe où aussi simple et aussi courte, parce que je suis vieux ! Tu gardes l'illusion des jeunes : que la vie reste libre tant qu'elle cache de l'imprévu. Je ne t'en veux pas, égoïste. Tu as les défauts de ton âge, et un autre encore : car au fond tu es un bohème.
Oui, un bohème..., Ha ! Ha ! j'ai trouvé le mot. Il y a des êtres qui poussent ainsi, même dans les plantations bourgeoises, comme le chiendent dans les betteraves. Ce n'est pas moi qui les appellerai des maudits... Ils choisissent la meilleure part. Si j'avais su, peut-être, en mon temps... mais il ne faut pas recommencer toujours sa vie en songe. Il ne faut jamais détester ce qu'on est. Ça, c'est la vraie malédiction.
– Ah ! oui, reconnut Julien.
– Mon neveu a le cafard, dit le distillateur. Voilà le paysage de Saint-Achille qui agit déjà. Ou bien est-ce qu'il aurait des peines de cœur. Oui ? non dans le sacré Paris pourtant, avec mille francs que je t'envoie par mois, et tes honoraires ! Combien gagnes-tu avec M. Comte ?
– Neuf cent six francs.
– Cela fait bien des cigares. Et tu vends bien quelques petites gravures ? A ta place, je serais heureux. Veux-tu changer ta peau avec moi ? Ah ! vingt milliards de dieux ! qu'est-ce qu'elle cherche donc, la science, si ce n'est de faire rajeunir les vieilles bêtes ? à quoi sert-elle, je te demande un peu ? Allons, Julien, c'est toi qui fais la tête, et moi qui te remonte ! Et malgré mes drames domestiques ! Et malgré l'arrivée de la sainte famille de Gouin !
Ils parvenaient à la distillerie. Le pavillon de M. Drémoncourt donnait sur un jardin dessiné, mais tout nu, qui rejoignait les prés et les bois. A l'horizon, deux cônes noirâtres indiquaient le pays des mines, les terrils de charbon, Le ciel était bas : des corbeaux erraient déjà comme une fumée sous les nuages, en criant, et soudain se taisaient, laissant le paysage à sa nudité, à son silence.
– A propos, demanda Julien. Et le drame ! et votre fidèle Irène ?
M. Drémoncourt se rembrunit :
– C'est vrai ; je ne pouvais te raconter par lettre toute cette histoire incroyable. La pauvre vieille a passé juste le lendemain du 14 juillet, tandis qu'il y avait encore dans la cour des lanternes et un accordéon pour le bal des ouvriers. Elle avait eu déjà deux ou trois crises d'étouffement, mais elle ne voulait pas se reposer, encore moins se faire suppléer par une jeunesse. On peut dire qu'elle est morte avec son tablier bleu ! Je l'ai relevée moi-même, je lui ai scarifié moi-même des ventouses ; et Dieu sait si je n'aime plus ce métier-là ! Elle disait juste : « Ça me fourmille, monsieur, ça me fourmille partout », avec sa langue pâteuse. Et puis : « Il faudra avertir à Caudry M. Meulemester. – Quoi donc ? c'est un parent ? – Non, non. – Un médecin ? non ? un notaire ? – Un « adepte » ! a-t-elle dit enfin.
« Je n'y comprenais rien du tout. Depuis vingt-cinq ans qu'elle me servait, elle ne m'a jamais parlé d'« adeptes ». Elle ne quittait non plus jamais la baraque. Tu sais qu'elle n'allait pas même à la messe, que je lui plaçais ses gages, et qu'elle me demandait vingt francs de temps en temps, sur son magot, pour s'acheter de la laine à tricot. Quand elle a été morte, j'ai fait chercher à Caudry le sieur Meulemester.
« Il est arrivé le soir même, avec deux femmes bizarres, des espèces de nonnes, ou d'infirmières en noir. Ils ont passé la nuit à l'auberge, sans vouloir veiller la pauvre Irène. C'est moi qui suis resté auprès de son lit, à boire le café sans chicorée, qui était bon pour la première fois : car enfin elle avait de sacrés goûts en cuisine ! Tu me vois devant les bougies, luttant contre le sommeil, farfouillant un peu dans ses nippes pour rassembler son héritage, avant de dénicher les héritiers, belle corvée mon ami ! J'étais attaché à cette bonne vieille, après tout : Vieille ? elle avait trois ans de plus que moi. Mais éreintée et un peu hébétée aussi. Qu'est-ce que je trouve dans ses paquets de linge : des brochures bleues ou vertes qu'elle recevait, écrites en un charabia impossible, et intitulée l'« Unitif ». Cela lui venait de Belgique, et cela m'avait l'air de prêcher l'Antoinisme, une espèce de nouvelle religion, oh ! une religion pour les pauvres bougres... Naturellement, j'ai jeté les papiers au feu : cela pourrait faire beaucoup de mal. Je n'ai su que le fin mot que le lendemain.
« Le sieur Meulemester arrive donc avec ses acolytes : vêtu d'une lévite jusqu'aux talons, il apportait un drap vert-chou dont il a fait couvrir le cercueil, au grand épatement des gens d'ici ; et il s'est prélassé devant la charrette en promenant une espèce d'écriteau carré où il y avait un arbre peint et ces mots : « La science de la vue du mal ». Il m'a montré un papier signé (si on peut dire) de la pauvre Irène, qui exigeait des funérailles « antoinistes », c'est-à-dire ce carnaval, et en fin de compte, la fosse commune (tu entends, Julien !) le trou au bout du cimetière, le silo où l'on ne jette ici que les os déterrés et les vieilles couronnes, avec défense de jamais avoir son nom sur ce misérable tombeau. Tu penses si j'étais furieux ! J'avais d'abord l'air d'un pingre, d'un abominable dégoûtant, devant tous les gens de l'usine qui regardaient le cortège, et qui n'en croyaient pas leurs yeux. Heureusement que le sieur Meulemester, avec son attirail, éveillait l'attention, me sauvait la mise. Il a récité au cimetière des phrases ridicules, en langage d'école du soir : la conscience, la matière, le développement intellectuel, que sais-je ? Le bruit s'est répandu vite que ce gibier représentait des Antoinistes ; et il y a eu des gens pour trouver que des funérailles pareilles, c'était crâne, c'était grand... et que la vieille Irène avait été une sainte à sa façon. Le nommé Meulemester, a replié son drap vert ; ses donzelles ont distribué des papiers. Le curé, m'a-t-on dit, contemplait l'affaire derrière ses rideaux, d'où il voit la porte du cimetière. Les crétins qui se disent ici bolchevistes ont raconté le soir, à l'estaminet, que la fosse commune devrait être rendue obligatoire. Et puis tout cela s'est oublié ; le notaire s'occupe de trouver des ayants-droits au petit magot de la pauvre Irène. Rendons cette justice au sieur Meulemester et à sa nouvelle religion : c'est qu'ils n'ont pas capté le testament ni réclamé de casuel... Mais faut-il qu'il existe des abrutis en ce monde !
A ce moment, la nouvelle servante se montra sur le perron. C'était une grosse Flamande, veuve d'un marin disparu, et qui avait été cordon-bleu à Dunkerque.
– Celle-là au moins, dit M. Drémoncourt, elle n'a rien de la prophétesse. Tu verras sa cuisine ! Il faut avouer qu'elle se boissonne tous les samedis, et le chauffeur la console de ses malheurs quand il l'emmène faire son marché. J'aime mieux cela. Mais je pense à la pauvre Irène qui soufflait en se traînant de pièce en pièce, et qui maintenant dort comme un chien à l'endroit des pots cassés et des grilles en morceaux... Ah ! pouah ! c'est joli, ce qui nous attend tous !
André THERIVE.L’Ère nouvelle, 19 janvier 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 18 Novembre 2021 à 10:46
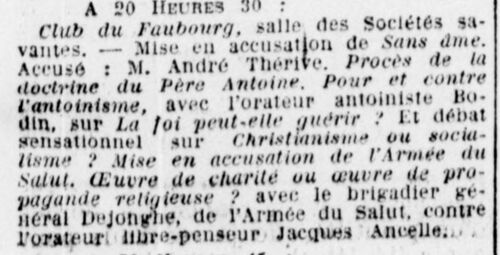
Conférence de Henri Bodin :
Mise en accusation de Sans âme. Accusé : M. André Thérive. Procès de la doctrine du Père Antoine. Pour ou contre l'antoinisme, avec l'orateur antoiniste Bodin, sur La foi peut-elle guérir ?La Revue hebdomadaire, 16 mai 1929
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 9 Avril 2020 à 12:19
L'ŒUVRE littéraire
LES LIVRES DE LA SEMAINE
Quelques romans
Il y a deux sujets dans Sans âme, d'André Thérive, il y a du moins l'étude de deux milieux. L'un est un milieu secret, presque inaccessible, constitué par une petite secte religieuse dont la chapelle se trouve au quartier de la Butte-aux-Cailles et qui porte l'étiquette d'« antoiniste », du nom de son fondateur. L'autre, c'est le music-hall, le monde des petites danseuses, des figurantes, des « marcheuses », selon l'expression du métier. D'un milieu à l'autre, de la rive droite à la rive gauche, va et vient le principal personnage, Julien Lepers, assistant à je ne sais quel laboratoire de psychologie mystique expérimentale, qui finit par perdre sa place et par accepter un simple emploi de commis. Il a été l'amant d'une petite « marcheuse » qui se sachant enceinte et s'étant juré de ne plus le revoir après s'être donnée une fois à lui, s'est suicidée. Le récit de cette fin forme le plus émouvant chapitre du livre, d'ailleurs fort beau d'un bout à l'autre, mais un peu déconcertant, voire désespérant, et qui laisse un arrière-goût de désolation amère.
Au delà des données immédiates et concrètes de Sans aime se révèle en effet, l'intention de l'auteur de nous rendre sensible l'abandon de l'âme moderne, la dégénérescence du sentiment religieux dans le peuple, la noire ivresse de vivre qui a remplacé chez nos contemporains les supports moraux traditionnels. N'avant point pour habitude de discuter les idées, la philosophie des romanciers, surtout quand ils ne présentent pas une thèse en bonne forme et se contentent de laisser certaines constatations se dégager honnêtement d'elles-mêmes, je ne vais pas bien entendu, remontrer à M. Thérive qu'il a tort et lui vanter l'efficacité de la morale laïque considérée comme aliment spirituel des masses populaires : Je préfère lui faire observer qu'au point de vue de la technique romanesque son livre, où abondent des pages remarquables, notamment des descriptions de faubourgs et où règne, avec un style aisé, fluide, un ton fort élégamment familier, serait peut-être plus satisfaisant pour le moyen lecteur si l'intérêt tardait moins à s'y fixer. L'influence de Huysmans est si manifeste dans cette peinture d'une secte mystique assez cocasse qu'on hésite presque à la signaler. Mais ce par quoi M. Thérive l'emporte évidemment sur son maître et sur tous les naturalistes dont il semble si étrangement féru, c'est l'écriture.L'Œuvre, 31 janvier 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 25 Février 2020 à 12:51

Auteur : André Thérive
Titre : Les Portes de l'Enfer
Édition : Bloud et Gay, Paris, 1924
Recensions :
André Thérive
Les Portes de l'Enfer
Voici un livre d'érudition vraie, qui, en deux cent vingt-cing pages, remplacera pour le lecteur curieux une grosse bibliothèque. Il intéressera tous ceux qui pensent que la science contemporaine laisse en dehors de ses investigations tout ce qui fait le sel du monde, tout ce qui préoccupa et préoccupera toujours l'humanité pensante, je veux dire le mystère. Sans l'inconnu, c'est-à-dire sans un plan supérieur proposé à nos imaginations, aucun progrès ne serait possible et l'homme ne se distinguerait en rien de l'animal.
Sous ce titre : Les Portes de l'Enfer, c'est donc, en réalité, tout ce qui constitue la substance humaine que M. André Thérive a résumé. L'art et le satanisme, la vague théosophique, le spiritisme devant les lettres et la philosophie, la leçon de la Kabbale, l'ancêtre de La Divine Comédie, la légende de Dante hérétique, le pessimisme éternel, autant de chapitres que l'on ne saurait résumer, mais que l'on pourrait développer, au contraire, en vingt volumes.
Ce qui nous plaît chez l'auteur, c'est son sens critique aigu qui, malgré certaines préférences évidentes, lui permet de porter des jugements de bon sens sur les questions les plus embrouillées. Je n'en veux pour exemple que les mystères du Graal, dont les complications inouïes seraient bien faites pour dérouter le plus laborieux pondeur d'in-folio allemands.
A vrai dire, si l'on se perd dans la symbolique, on risque de s'égarer définitivement. La voie philologique paraît plus simple. D'où vient le mot Graal ? En Savoie et en Suisse, grâla, ou crôl, signifient une jatte. En Normandie, en Auververgne, graset désigne une lampe-vaisseau. Peut-être y a-t-il là aussi un jeu de mots, grasalis signifiant un récipient en bas-latin, et gradalis, un livre pieux. Le graal signifierait donc, à la fois, un livre d'initiation et une soupière. Si l'on sait que grasalis désignait dans le Midi une mesure de pêcheur pour le poisson, on comprendra l'origine de l'idée du Riche Pêcheur. D'autres équivoques sur le plat et la lance enrichissent également la légende. Quelle peut être également la transformation apportée dans la légende du Graal par l'idée chrétienne ? On sait, en effet, (Montalembert nous l'a tout au long raconté), quelle fut l'indocilité des chrétiens de Bretagne contre l'autorité catholique. Le Graal venait, en effet, de Grande-Bretagne, où il avait été apporté d'Orient, et la Table Ronde a failli représenter une troisième communion mystique. Les moines de Cîteaux, dans leur réaction contre les frivolités de la féodalité galante, ont dû tourner les légendes du Graal vers une fin morale et théologique. vers une fin, disons-le, plus catholique. Et le Graal ne fut plus qu'une sorte de figure de l'Eucharistie, sa Quête représentant le voyage du chrétien à la recherche de son Dieu, qu'il n'atteint que dans la mort, comme on le voit par l'exemple de Lancelot et de Galaad. La légende du Graal n'est point, du reste, sans porter en elle un ferment d'hérésie, et l'auteur était bien placé pour le découvrir. Salomon l'avait dit par avance à Galaad :
- Si tu veux être en paix, garde-toi des femmes sur toutes choses.
« Entendons bien, nous dit M. André Thérive. Ces préceptes qui adjurent le monde de finir, le monde qui insultait Dieu par son existence même, ces préceptes ne posent pas une morale supérieure et idéale ; ils supposent bel et bien une espèce de blasphème et de négation. Aussi les néo-bouddhistes du dernier siècle n'ont-ils eu garde de le négliger. Parsifal, le guerrier-vierge, devenu schopenhauérien, a incarné pour Wagner la négation du vouloir vivre. »
Nous sommes heureux de l'entendre dire à l'auteur du Plus Grand Péché, dont nous parlâmes ici même à l'occasion du Prix Balzac.
Si l'on voulait trouver une raison à cette fin de toutes choses, peut-être pourrait-on la trouver, à mon sens, dans le désir très banal de conclure qui est particulier au roman, fût-il de chevalerie. Une belle histoire doit se terminer en apothéose ; l'apothéose suppose quelque chose de surhumain ; l'auteur, avant de quitter tous ses personnages, doit les conduire jusqu'au bout de leur vie ou de leur geste ; il me semble bien que toutes les théories négatives naissent de ce besoin obscur de conclure, aussi bien dans le roman qu'en philosophie. La théorie du non-être, celle de la fin des temps aventureux » n'est-elle point, à bien prendre, qu'une forme mystique des faciles dénouements de théâtre, lorsque l'auteur, sentant venir la « fin du troisième acte, met dans la main de son héroïne ou de son héros la facile conclusion du revolver ?
Ne l'oublions pas, - et M. André Thérive est le premier à nous le faire remarquer, c'est souvent dans les idées populaires les plus simples qu'il faut trouver l'origine des conceptions philosophiques les plus embrouillées.
G. de Pawlowski
Les Annales politiques et littéraires, 8 février 1925
Les Portes de l'Enfer
par André Thérive
Point n'est besoin de profondes connaissances exégétiques pour savoir que cette métaphore : les portes de l'Enfer, désigne les puissances diaboliques, auxquelles il ne sera jamais donné de prévaloir contre l'Eglise du Christ ; point besoin, non plus, de forte culture gréco-latine pour se rappeler qu'au 19e chant de l'Odyssée, Homère affirme que les songes véridiques sortent du royaume de Hadès par une porte de corne, tandis que les trompeurs montent par une porte l'ivoire. Ingénieuse fiction, bâtie sur un simple jeu de mots (kéras, corne, avec krainô, accomplir ; éléphas, ivoire, avec éléphairomai, tromper) et reprise par Platon dans le Charmide et Virgile dans l'Enéide. Et voilà donc limpide, à présent, le titre à première vue un peu mystérieux du morceau livre de M. André Thérive. Non seulement la cité de Dieu est attaquée par les forces sataniques, mais aussi la cité humaine que le respect de la liberté de penser livre sans défense à des rêves et des folies qui, d'origine infernale, menacent la civilisation.
Ces rêves et ces folies, d'apparence souvent innocente, doctrines fuyantes et sinueuses : spiritisme, théosophisme, kabbale... il importe de leur arracher le masque ; tout au moins d'attirer sur elles une attention raisonnable. C'est ce qu'a fait M. André Thérive en des études qui sont d'un philosophe savant et subtil. Aussi bien, n'a-t-il pas oublié la porte de corne. Toutes les fois qu'il en a l'occasion il y regarde afin d'y chercher vérité et poésie. Il s'en trouve même dans les pires erreurs. Satan ne fut-il pas le plus beau des singes ?
Et il reste le plus malin ! Ne s'est-il pas glissé dans les pages mêmes que M. André Thérive vient d'écrire pour combattre ! Comment, en effet, si les portes de l'Enfer n'ont pas quelque peu prévalu contre le Grammaire-Club, comment expliquer, sans la plume de M. André Thérive, ce mignon solécisme : « Ce ne saurait être pour rien que les esthètes purs ont posé en blasphème contre Dieu la dévotion envers l'art... » (page 14) et cet autre, bien plus grave : «... le Pimandre est encore facile à se procurer » (p. 36), répété p. 76. ... le P. Lucien Roure dont les deux ouvrages sont fort aisés à se procurer ». Oui, oui, le diable est bien malin ! - (Bloud et Gay.)
Henri CASANOVA.
Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 28 mars 1925
On peut lire en page 9, juste ce petit signalement contre l'orientalisme :
"Aujourd'hui, l'on voit communément, sous les espèces d'un « orientalisme » d'aloi confus, reparaître l'antique dualisme, dont le satanisme est seulement une figure plus franche. En Amérique, en Belgique, en Allemagne, un peu partout, on voit surgir des messies indulgents et bénisseurs dont le vieux manichéisme semble bien être la doctrine suprême. Or dans les plus innocentes prédications qui vous proposent tour à tour l'amour universel, l'abdication de l'intelligence, la négation du mal, de la souffrance, et de la matière, qu'elles assimilent à ce principe, le critique informé subodore assez vite l'évangile mensonger de la haine, de la charnalité et du culte des ténèbres. Ce sont là de grands mots ; mais quand les employer sinon en pareille circonstance ?"
Sans évoquer l'Antoinisme, c'est bien ce dont parle l'auteur. votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 11 Juin 2019 à 17:16
LES “SANS-AME”
Vers une religion nouvelle
par PIERRE MAC ORLAN.
J'emprunte le titre de cette chronique au livre de M. André Thérive. Il me paraît s'appliquer non seulement au remarquable roman d'un grand écrivain, mais encore à tous ceux qui errent dans les rues ou à travers les accessoires de la rue, comme des « corps sans âme ». Vulgairement, un corps sans âme est un personnage désemparé. C'est un fantôme provisoire, qui appartient, quand il a dépassé un certain âge, aux romanciers, et qui irrite les parents quand il est jeune. Cette phrase : « As-tu fini de tourner comme un corps sans âme ? » ne fait présager rien de bon pour un enfant. Ce malaise, qui parfois précède les enthousiasmes saugrenus de la puberté, chez un adolescent isolé, s'empare quelquefois de l'humanité quand il arrive à celle-ci de retomber dans cet état de transition qui n'est plus l'enfance et qui n'est pas encore l'adolescence.
En ce moment, l'humanité, secouée par quelques crises parfaitement connues, cherche, comme un corps sans âme, une issue pour sortir de ces vieilles chambres à coucher. Mis à part les paysans qui appartiennent aux choses du sol, comme l'arbre et l'herbe, le reste des hommes travaille parce que le travail est une obligation sociale qui entraîne la mort quand on se refuse à l'accepter. Mais personne ne sait plus très bien vers quelle apothéose morale le travail de chacun doit aboutir. Beaucoup craignent que des guerres nouvelles ne soient le résultat de leurs petits efforts quotidiens et d'autres pensent que vingt années de bureau consciencieusement vécues au goût de l'administration se convertiront en un phénomène instantané d'insécurité absolue.
Je pense que cette insécurité, devinée et crainte, est la seule raison qui le puisse expliquer l'inquiétude générale. Nous sommes encore loin d'une religion nouvelle, qui pourrait enfin donner une expression à la fois littéraire et morale aux petits mystères sociaux de notre temps.
Pour l'instant, nous connaissons de nombreuses petites religions, que l'on pourrait dire de poche, car on emporte avec soi les objets du culte. Le scapulaire cède la place à l'éléphant blanc, au sou percé et à toutes les matérialisations plus ou moins décoratives de l'espoir de conjurer le mauvais sort. Au moment même où la science nous donne la T. S. F., la télévision et toutes les merveilles qui attendent dans des laboratoires leur forme définitive et publique, la croyance en la fatalité triomphante domine les hommes. On conduit une vingt-cinq chevaux sous la protection d'une poupée-mascotte, et l'on prend la route en touchant du bois. Tout cela éparpille cette force, la crédulité humaine, en mille petites chapelles qui, réunies au profil d'une entreprise sentimentale, pourraient cette fois constituer une force capable de bâtir, elle aussi, des cathédrales. Rien n'est plus émouvant et plus séduisant qu'un effort formidable quand il aboutit à la réalisation d'une œuvre qui ne s'adapte à rien de pratique, mais dont on peut dire qu'elle a été édifiée avec toutes les forces sentimentales, secrètes et inemployées, d'un nombre illimité d'individus.
Quelques-uns se dirigent bien encore vers les anciens temples. Mais dans cette foule qui prie, combien sont prêts aux suprêmes sacrifices pour la défense de leur foi ? Il est évident qu'une religion nouvelle, et qui tiendra compte vraiment de la présence du pauvre et du riche pourra ressusciter cet état de grâce qui insensibilise les fidèles contre les supplices des bourreaux et les boniments goguenards des sceptiques. Des mots seront revalorisés, en quelque sorte, des mots usés jusqu'à la corde comme : honneur, vertu, fidélité, fraternité, justice, etc. Le mot liberté a tout de même gardé un peu de sa valeur sentimentale, et je crois qu'il restera l'idéal le plus pur d'une société qui va excessivement vite vers un destin que j'ignore.
Ce qu'on pourrait espérer de cette religion nouvelle serait qu'elle fût moins soumise à cet hypocrite amour de l'humanité pour elle-même. Il est convenu de présenter la race humaine en un seul bloc. Si au point de vue physique cette estimation, peut paraître assez logique, il n'en est pas ainsi au point de vue spirituel. L'expérience a prouvé qu'en général les hommes n'étaient point organisés pour vivre ensemble. La peur, et quelquefois des cas assez prévus de folie collective peuvent les rapprocher pour quelque temps. Ils tâchent alors, et sincèrement, de donner un sens pratique aux mots cités plus haut. L'indifférence – quand ce n'est pas la haine – des hommes pour les autres hommes est malgré tout impressionnante. Mais c'est de cette haine, ou simplement de cette indifférence que naît cette bonté purement littéraire qui donne à certaines personnes sensibles des regrets distingués. Ces regrets distingués, soumis aux exigences de la liberté de penser, deviennent des romans qui sont émouvants, parce que chacun, en les lisant, se sent un peu responsable de cette angoisse, de cette tristesse et de ce mystère, qui donnent aux créations littéraires une vérité qu'il est difficile de découvrir sans le secours de certains intermédiaires, bons conducteurs des petites forces secrètes qui nous animent.
M. André Thérive vient d'écrire un roman tel que l'époque l'exige, c'est-à-dire un témoignage devant quelques cas de désespoir, que la plupart des hommes ne peuvent contrôler que par l'intermédiaire d'un écrivain. L'honnêteté d'un écrivain est l'équivalent, à elle seule, de l'honnêteté de sept mille personnes. Ce qui indique déjà un « tirage » satisfaisant. Le livre de Thérive me paraît – je ne suis pas un critique littéraire, et c'est pour cette raison que je prends quelques précautions – ce roman, Sans âme, me parait un des livres les plus curieux de notre époque. C'est un livre d'aventures qui pénètre en profondeur dans l'arrière-boutique cérébrale de deux filles et de quelques hommes parfaitement dépourvus de ce pittoresque social qui facilite les recherches. Il est difficile d'émouvoir plus honnêtement ; sans ruse et sans se mêler soi-même à la misère des autres.
Lucette et Lydia sont deux jeunes femmes absolument réduites aux apparences de toutes celles qui peuplent la rue, pour un soir... un soir de 14 juillet, par exemple. Elles n'offrent rien de conventionnel, cependant, car s'il y a des lois dans la vie des hommes, rien de conventionnel n'existe réellement. Et c'est ce qui donne à notre existence cet attrait dont les plus déshérités demeurent les esclaves...
Lucette et Lydia, jeunes filles, ne sont pas des filles publiques. Leur sentimentalité est d'une qualité plus fine. Elle est même tout à fait délicate chez Lydia. Les deux femmes cherchent à se défendre de l'homme, mais par des moyens qui reflètent très bien le désarroi sentimental de notre temps. Autour de ces trois personnages – les deux femmes et l'homme qui est entré dans la vie de ces deux femmes – un décor assez commun et très familier prend une qualité extraordinaire et se peuple de fantômes grâce à M. Comte, qui mesure les réactions motrices et sexuelles des sergentes salutistes, grâce à M. Pardoux, qui sait se déboîter légèrement les parois de la fontanelle comme Philoxénès, mage autrichien, et grâce à la présence de Mme Lormier et des fidèles de l'antoinisme. Le fantastique, qui emprunte souvent les formes les plus mesquines pour se glisser sous les portes les mieux closes, entre par quelques fissures, dans ce livre, qu'un autre écrivain aurait peut-être – je pense à Charles-Louis Philippe – mieux fermé. C'est pourquoi je préfère la sensibilité de M. Thérive et son art qui n'est pas imperméabilisé.
Ce livre est mobile comme la vie et la mort. Thérive a tenu compte de la mobilité de la matière. Ces personnages sont maintenus au rythme de la vie. En lisant ce roman, on n'éprouve pas cette impression de trébucher comme celui qui, sans habitude, tente de poser le pied sur un escalier roulant. Notre propre part de mystère et de tragique se mêle sans effort aux créations de l'écrivain. C'est ainsi qu'il faut voir et aimer la rue ; c'est du moins ainsi que j'aime à entendre parler de la rue, d'une ville que je connais, et de fantômes qui, çà et là, semblent agir inutilement pour le plaisir pervers d'on ne sait qui. Dans le livre de Thérive, chacun cherche à sa façon la connaissance de Dieu. Cette recherche de la connaissance de Dieu pour des gens qui n'ont plus confiance dans les anciennes directives est encore un des éléments du fantastique social de notre temps. Certains, parmi les plus pauvres en imagination vont jusqu'au couperet de la guillotine pour atteindre la révélation. C'est tout cela et autre chose que je ne peux juger et qui appartient à André Thérive, qui font de son dernier roman une œuvre dont l'importance a déjà été soulignée, sans doute depuis longtemps.
Pierre MAC ORLAN.Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 25 août 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 27 Mai 2019 à 17:39
QUERELLES DE LANGAGE
J'ai encouru récemment les foudres de Cassandre, l'hebdomadaire bruxellois, pour avoir, à peu près, écrit que la vie privée du Père Antoine, fondateur de la religion antoiniste, aurait pu être celle de n'importe quel ouvrier du Borinage. Or, le Père Antoine était de Jemeppes-sur-Meuse, dans la banlieue de Liége, et le Borinage, c'est une région du Hainaut qui contient Jemmapes (où eut lieu la bataille), et délimitée à peu près entre Maubeuge et Mons, entre Valenciennes et Fleurus...
Sur quoi on m'accuse d'observer « la tradition des chroniqueurs français pour qui la géographie de la Belgique est une chose essentiellement approximative ». Je ressens vivement ce reproche, mais je n'ai jamais confondu Jemeppe et Jemmapes. Borinage doit s'écrire en français comme nom commun, avec une minuscule. Le Larousse du xxe siècle donne au mot le sens général d'exploitation des houillères dans la région du Nord, et même d' « ensemble des ouvriers qui travaillent dans les houillères ». Le même dictionnaire comporte aussi borin, borine, pour désigner un ouvrier ou une ouvrière de cette profession. Le Littré, vieux de soixante ans, offrait déjà les mêmes mots dans le même sens. Et le Père Antoine, ayant commencé par travailler à la mine (à la fosse, comme on dit là-bas), a tous les droits d'être nommé en français un ouvrier du borinage.
L'histoire des mots figurés offre mille exemples analogues, où le vocable propre tantôt prend une acception locale, particulière, sans cesser d'avoir sa signification générale, tantôt s'élargit, en dehors de ses frontières primitives, Est-il besoin de rappeler damas, rouennerie, cordonnerie (cuir de Cordoue) et tous les mots qui ont donné lieu, comme champagne, par exemple, à des procès commerciaux ? Dans le cas de borinage, on peut penser qu'une restriction géographique du sens a été pratiquée en Belgique, bref que le nom propre est postérieur au nom commun. Si je me trompe, si les borins ne sont à l'origine que les ouvriers ou habitants du pays Borinage, je serai heureux qu'on me le démontre.
En attendant, rappelons que la France elle-même a usurpé le nom de la Francie des Francs, comme l'Angleterre recouvre peu à peu l'idée de Grande-Bretagne, voire d'Empire britannique. Amérique a une fortune analogue. Les Canadiens, Américains à nos yeux, disent l'Amérique en parlant des Etats-Unis.
André THERIVE.Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 4 avril 1936
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 20 Mai 2019 à 11:47
XX SANS AME, roman, par André Thérive (Collection « Les Ecrits » n° 5, Grasset édit.). — Ce roman nous révèle une partie – et la plus émouvante – de ce qu'on découvre lorsqu'on sait se mêler à la vie intime des faubourgs parisiens.
André Thérive s'est mêlé à cette vie. Avec une intelligence aiguë, il a pénétré la pensée des pauvres gens qui s'agitent dans leurs passions comme dans le décor d'une triste féerie.
Sans âme : c'est-à-dire sans foi véritable, sans motif d'enthousiasme profond, sans idéal suffisant...
Cette œuvre d'un style cursif et d'une trame toute simple (deux lamentables idylles rehaussées de promenades pittoresques chez les Antoinistes et dans des décors parisiens à la Huysmans) cette œuvre soulève vraiment de hautes questions et de la façon la plus poignante. C'est un livre de pessimisme et de sensibilité qui fait grand honneur à André Thérive. — (II.)LES TREIZE.
L'Intransigeant, 28 janvier 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 8 Mai 2019 à 16:20
Sans Ame, de M. André Thérive, est un des bons romans de cette année. Si ce n'était que cela, je n'en parlerais pas : la critique est ici trop bien faite par notre brillant collaborateur André Billy. Mais Sans Ame est, au fond, un roman « à thèse ». Ceci de la façon la plus adroite, la plus neuve ; cette « thèse », il n'y a que le titre du roman qui la signale, qui l'affirme. Hors ce titre, l'auteur n'expose, ou ne prétend exposer, que des faits, un état social, l'attitude enfin d'une très grande partie de la population parisienne en présence du problème religieux.
C'est bien simple : selon M. André Thérive, elle l'ignore. Un demi-siècle d'enseignement laïque – le romancier n'en dit mot, il n'aurait garde, dans un ouvrage d'imagination, d'employer des termes si décisifs et grossiers – a déraciné, supprimé le christianisme, et surtout le catholicisme.
Cette religion deux fois millénaire a en somme disparu. Beaucoup d'enfants ne sont pas baptisés. Ceux qui le furent se demandent sincèrement : « Est-ce que je l'ai été ?... » Ils ne s'en souviennent plus. Ignorance totale des dogmes, des rites, des sacrements. Une des petites filles qu'on rencontre à une page de ce roman remarquable dit : « La communion ? Je sais ce que c'est : une chose que les curés vous mettent dans la bouche pour vous confesser ! » Elle confond ainsi le sacrement de la Pénitence et celui de l'Eucharistie.
Alors, comme cette population est intelligente et sensible encore plus sensible qu'intelligente – c'est chez elle une inquiétude obscure, confuse, du mystère de l'après-vie, parfois aussi puissante, aussi dominatrice que chez le primitif de l'âge de la pierre. Résurrection du vieil animisme. Epouvante devant la mort, devant les rêves « qui doivent signifier quelque chose ». Des demi-primaires se réfugient dans la magie, instituent des cultes bizarres ; d'autres dans « l'Antoinisme », déformation ingénue du Christian Scientisme américain, mélange naïf de spiritisme, de « fluidisme », et de biblisme qui compte 300.000 adeptes en Belgique, possède maintenant un temple à Paris, et où l'on rend hommage au Christ, mais également au Diable : car le Diable, c'est la matière, et ne sommes-nous pas formés pour trois quarts de matière ? ... Et dans ce roman, qui arrive à l'émotion, au pathétique par des moyens inédits, comme dénudés, poignants, l'héroïne, une petite marcheuse de café-concert, meurt à dix-sept ans, enceinte de cinq mois, après un incendie et une chute dans « sa boîte », murmurant : « Mourir, ce n'est rien... mais je ne veux pas finir ! Non, je ne veux pas finir ! »
... Pendant ce temps un certain M. Comte, dans son Laboratoire de Physiologie des Religions, créé par le Collège de France, s'efforce de saisir les réactions de l'émotion religieuse, aidé des sphygmographes et des manomètres à mercure.Donc, si je ne me trompe, voilà bien la thèse : « Le peuple a été élevé « sans âme ». Vaguement il en cherche une. Il ne la trouve pas. M. André Thérive se garde fort d'ailleurs de dire ouvertement qu'il le regrette. Il semble seulement qu'il fasse entendre une protestation en faveur de l'âme immortelle : « S'il y a quelque part un jugement pour remettre les humiliés dans la gloire, ne vaut-il pas mieux être des victimes que des bourreaux ? »
Je veux bien, moi, naturellement ! Je ne demande pas mieux que de ressusciter ! Mais ça ne m'empêche pas de me demander pourquoi, s'il y a un démiurge ou un bon Dieu, il permet qu'il y ait sur cette terre des victimes et des bourreaux. A cela les religions spiritualistes n'ont jamais bien clairement répondu, et il ne semble pas non plus qu'elles aient, mieux que le matérialisme « officiel » de nos jours, préservé, accru, la moralité des peuples.
Car voici que ressort du roman de M. Thérive un fait bien singulier ! Il n'apparaît pas, à le lire, que ces misérables petites filles nées entre la Glacière, la place d'Italie, Saint-Médard et le boulevard de l'Hôpital, et devenues ouvrières dans les fabriques de sucre et les ateliers de cartonnage, ou bien qui dansent nues dans les music-halls, vaillent moralement moins que leurs devancières du dix-neuvième ou du dix-huitième siècle. Elles ont leur fierté, elles ont leur honnêteté, elles ont leur « morale » qui pour n'être pas celle du catéchisme leur maintient une espèce de dignité. Et, entre celles que rencontrait Restif de la Bretonne dans les mêmes parages, il y a un siècle et demi, et celles qu'a vues M. Thérive, l'avantage est plutôt pour celles-ci.
Et puis, n'a-t-il pas exagéré la défaite des religions « établies » ? On semble discerner, au contraire, à bien des signes, qu'elles exercent une influence beaucoup plus active qu'il y a trois ou quatre générations.Pierre Mille.
L’Œuvre, 27 mars 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 30 Avril 2019 à 10:06
Sans âme
Le nouveau roman de M. André Thérive me laisse bien perplexe... Il abonde en morceaux délicats, en morceaux vigoureux. Mais, comme dans les Souffrances perdues, l'idée principale est difficile à saisir, à garder... Elle est pareille à un filet d'eau qui, tantôt apparaît à ciel ouvert, tantôt se glisse sous terre ; et alors il faut faire le sourcier, pour la retrouver. L'action se passe, en grande partie, autour de la Bièvre, ou de ce qui reste de la Bièvre. Ainsi, la comparaison s'impose. Et puis, M. Thérive aime Huysmans. Et puis, il y a, dans Sans âme (M. Grasset, éditeur), un garçon, Julien Lepers, qui, vraiment, vit à vau l'eau... Et il y a encore, dans Sans âme, un mélange de « naturalisme » 1885, et d'aspirations religieuses renouvelées de Huysmans ; il y a aussi de l'ironie « chestertonienne ».
Bref, c'est un livre très complexe ; un peu fuyant.*
* *Un nommé Julien Lepers, un paresseux, un rêveur, mais rêveur sans nobles rêves, rêvasseur plutôt, de pensée assez lente, un instinctif tracassé vaguement d'intellectualisme ; un sensuel, travaillé par on ne sait quel mysticisme d'homme du Nord, qu'il n'essaye pas d'éclaircir, de fixer, en est le protagoniste. Peut-être voudrait-il s'occuper de son âme... Mais son cerveau nébuleux, hésitant, n'est pas de ceux qui abordent bravement les grands problèmes. Il pressent que des problèmes existent. Il voudrait bien que ses perplexités sur l'âme, sur Dieu, sur le bien et le mal fussent résolues. Seulement, il manque d'énergie, pour chercher une solution.
Il est préparateur du professeur Comte au Laboratoire de Physiologie des Religions. M. Thérive a inventé cette science, pour pouvoir la railler à son aise. Le professeur Comte est un grotesque. Il étudie les « réactions motrices sexuelles, auditives des jeunes filles de l'Armée du Salut ; il voudrait savoir combien il y a de rachitiques et de tuberculeux chez les mystiques ; il rêve d'une « dynamogénie religieuse ». Le professeur Comte est de ceux pour qui l'univers est vide d'âmes. Il est fort ridicule. Mais je ne sais pas s'il existe. En tout cas, ce personnage caricatural ne prouve rien contre les savants sérieux. C'est ici que M. Thérive me fait penser à G. K. Chesterton et à ses chapitres de l'Homme éternel, si fragiles, contre la préhistoire, par exemple. Les arguments de Chesterton ne détruiront pas la préhistoire, la ridicule querelle de Glozel non plus. Il faut tenir bon !... Eh bien, les ironies de M. Thérive, bien plus subtiles et plus dangereuses que celles de Chesterton, ne détruiront pas la psycho-physiologie. Il y a des grotesques de la science, hélas ! Mais après ?
Julien fait, au Madelon-Cinéma, que l'assassinat d'une fillette a rendu fameux, la connaissance d'une femme assez banale, Lucette, et se met en ménage avec elle. Il l'aime pour la forme de sa bouche et de son menton, qui déclenchent en lui un violent élan de sensualité. La vie que mène Julien avec Lucette, leurs parties de cinéma ou de campagne sont d'une mélancolique platitude... Ces gens sont tous « sans âme ». Mais a comme je voudrais que M. Thérive précisât ce qu'il entend par « sans âme »... Cela semble un « effet de mots ». L'âme, pour le croyant, n'est pas un devenir, ni un possible, « fonction » de nos aspirations, de nos efforts vers le mieux. Elle est, tout bonnement. Et il ne s'agit que de la sauver. Il y a des « âmes avec foi », et des « âmes sans foi ». Il y a surtout des cervelles actives, en qui l'on a vite reconnu l'étincelle divine ; et de pauvres cervelles en qui l'esprit semble ne jamais s'agiter.*
* *Laissons Lucette. Aussi bien, Julien n'est pas très fortement lié à elle. Lucette a une amie, Lydia ; une fillette qui fait du cinéma, et du music-hall. Julien croit qu'on peut jouer avec ce petit corps, et ne soupçonne pas qu'une âme y est cachée, jolie, tendre... Il séduit laidement cette petite ; l'abandonne ; et quand elle est morte, par sa faute, il commence à se repentir. Je fais remarquer qu'aucune morale, même psycho-physiologique, n'est indulgente à de la séduction d'une enfant par un débauché ; et que, peut-être, l'exemple de Julien et de Lydia ne prouve pas grand'chose.
Chez ces êtres, chez ces espèces de zoophytes, que nous montre M. Thérive, – la petite Lydia est la seule qui pense..., – il y a pourtant une sorte de frémissement, d'appel mystique. Ils sont tout près d'accepter, eux à qui on n'a pas enseigné de religion noble, les superstitions les plus niaises, et d'adhérer à des « chapelles » suspectes. Les uns sont attirés par l'Antoinisme. Le propriétaire de Julien est chef d'une « église christique », qui rassemble une dizaine de fidèles rue Falguière. Ainsi trompent-ils leur soif d'idéalisme avec des cultes frelatés. Et l'on sent bien que M. Thérive offre à ces errants le port magnifique de la Cathédrale. Mais que ne le dit-il plus expressément ? L'antoinisme, le music-hall, la vie grise des quartiers populeux, le trouble des âmes, sans boussole... Que de sujets ! Le romancier a touché à tous, avec une adresse délicate et précise. Mais, en deux cent quatre-vingts pages, il n'a pu rien creuser. Et son livre – très bien écrit, je n'ai pas besoin de le dire, et bourré d'observations justes dire, – a, forcément, plus d'extension que de profondeur.La Liberté, 6 février 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 25 Avril 2019 à 17:11
Les possibilités de l’âme
[C]e que j’ai mal à l’âme !
— Joris-Karl Huysmans, En route1
Sans âme donne à lire la question religieuse sur deux plans, mais d’inégales valeurs aussi bien en ce qui a trait à l’évolution du héros qu’à l’élaboration de l’intrigue. Je parlerais ici d’une ambiance mystique, toile de fond d’un drame à l’avant-scène duquel se pose la question de l’âme.
Julien Lepers, trente ans, est préparateur au Laboratoire de Physiologie des religions. À vrai dire, on l’y voit assez peu, et chaque fois moins pour travailler que pour bavarder avec le directeur, qui y accumule et étudie diverses expériences mystiques. Outre son travail, d’autres événements placent Julien en contact avec des manifestations religieuses, sans qu’il montre un très grand intérêt. Quand M. Pardoux, son propriétaire et voisin de palier, amateur d’ouvrages mystiques, l’invite à l’accompagner « à notre petite Fraternité », Julien refuse, mais s’y rend ensuite en catimini, mû par la simple curiosité et le désir de « surprendre des âmes2 ». Julien n’en tire guère de profit, mais soupçonne peut-être une vérité moins fortifiante que ce qu’il attendait en ne reconnaissant pas M. Pardoux, « ce fidèle insolite qui plongeait sa tête dans ses bras et donnait l’aspect d’une soumission anéantie à une lassitude amère, à une torpeur désolée, proche du désespoir3 ». Il interroge aussi Mme Lormier, la tante antoiniste de Lydia Lemège, une danseuse dont Julien va s’éprendre peu à peu ; mais encore une fois Julien n’agit que par curiosité, sans jamais penser qu’il pourrait en tirer profit pour son propre compte, lui qui n’a guère d’âme. Aussi Henri Martineau n’a-t-il pas tout à fait tort lorsqu’il ironise :Dans son dernier roman [Sans âme] on rencontre ainsi à chaque page des Antoinistes. En comptez-vous beaucoup parmi vos relations ? M. Thérive, lui, ne peut remuer un pied sans marcher sur eux. C’est donc qu’il a buté dans un guêpier : pas du tout, ces différents Antoinistes ne se connaissent pas du tout entre eux et surgissent par le seul effet du hasard. […] Je ne chicanerais même pas du tout l’auteur sur l’arrivée de ses Antoinistes s’ils avaient une part véritable à l’action de son livre. Mais ils ne sont là que pour enjoliver un peu, si l’on peut dire, la toile de fond4.
En effet, le discours autour de l’antoinisme constitue finalement une sorte de décor, les traces de mysticisme ou d’occultisme étant disséminées un peu partout dans le texte sans arriver à prendre une forme réellement consistante. Le Laboratoire, l’antoinisme, la présence de M. Pardoux installent une ambiance qui sans doute relève de ces déviations de la mystique dont parlait Charpentier au sujet du Troupeau galeux5, mais que Thérive souhaite néanmoins placer en résonance avec la question de l’âme. C’est cette question qui fait le pont entre les deux « plans religieux » du roman, question par laquelle, par ailleurs, Sans âme croise En route.
Dans En route, au moment de l’une de ses nombreuses crises qui le trouvent insatisfait aussi bien de lui-même que des ecclésiastiques, dont il déplore l’ignorance et la médiocrité, Durtal rappelle à quel point la mystique du Moyen Âge est en « parfait désaccord » avec le modernisme6. Mais Durtal, par l’entremise de l’art, parvient à combler cet écart : « Enfin Durtal avait été ramené à la religion par l’art. Plus que son dégoût de la vie même, l’art avait été l’irrésistible aimant qui l’avait attiré vers Dieu7 ». Or, cet intermédiaire, qu’il fût sous la forme de l’art ou d’autre chose, fait défaut chez Thérive. Ici, Dieu n’est accessible d’aucune manière ; et les déviations de l’occultisme que donnent à voir les antoinistes ne prouvent pas Dieu, ils seraient au contraire les signes les plus évidents de la dégénérescence de la foi, de la déliquescence de la valeur et de la grandeur religieuses. Dans cet univers sans âme, Julien ne saurait d’aucune façon faire ce pas que réalise Durtal vers l’Église, cet « hôpital des âmes8 », et ne pourrait encore moins envisager « une cure d’âme dans une Trappe9 », ce à quoi Durtal consentira dans la deuxième partie d’En route.
Le populisme de Sans âme ne reconduit donc pas En route ; on ne refait pas davantage du Huysmans que du Zola trente ans plus tard. Mais dans l’esprit de Thérive et de Lemonnier, la fiction contemporaine maintient un lien plus évident avec l’auteur d’En route qu’avec celui de L’Assommoir, précisément parce que le vacillement du sentiment religieux ou la perte de la foi, qui contribue de manière décisive au « mal du siècle10 » et à « l’inquiétude11 » de l’après-guerre, trouve, dans le romanesque de la modernité qui s’impose à la fin du XIXe siècle, son exemple le plus convaincant chez Huysmans. Le but de la mystique, selon Durtal, est de rendre Dieu « visible, presque palpable12 ». Dans le roman de Thérive, c’est ce rôle que joue, en somme, le Laboratoire de Physiologie des religions. Or, cette « discipline nouvelle », dont les travaux se rattachent au Collège de France, est évidemment une bouffonnerie qui vise peut-être, dans l’esprit de Thérive, à caricaturer les travaux positivistes dont se réclamait Zola13. Le « roman expérimental » ne serait pas plus sérieux que les expériences du Laboratoire ou encore les croyances de pacotille des antoinistes.
De la sorte, substituer Huysmans à Zola comme maître du populisme était pour Thérive la meilleure façon de circonscrire la spécificité du roman moderne. Dans cet essai de redéfinition, qui conduit Thérive vers la « théorie » populiste, Sans âme se trouve à problématiser l’écriture du roman moderne en approfondissant l’écart entre Durtal et Julien Lepers, héros tourmenté et impuissant à faire entrer la foi dans la vie. Cet approfondissement, Thérive y parvient au moyen de la trame amoureuse qui traverse le roman, et qui permet d’aménager une certaine forme de spiritualité, fût-elle désespérée. C’est sur cette base que s’élabore le second plan du roman.
Julien entretient une relation avec Lucette Fauvel, dont il fait la connaissance à la sortie d’un cinéma. Mais peu à peu il se désintéresse de celle-ci au profit de la jeune Lydia, cousine de Lucette. Lydia provoque en lui un sentiment nouveau, une forme de jalousie qui engendre chez Julien « une mélancolie, un désespoir abattu, un dégoût de vivre ; c’était comme la menace d’une solitude, moins cuisante, mais plus durable que la menace d’une atteinte à sa personnalité14 ». Cette représentation que Julien se fait de Lydia introduit entre eux une émotion qui, lui semble-t-il, leur offre une âme en partage, qui à tout le moins le place dans des dispositions à la fois charnelles et existentielles qu’il n’a jamais connues auparavant. Un jour qu’il surprend Lydia « au meilleur moment de la mélancolie, de la misère15 », et peut-être parce que, comme le dirait Durtal, il est inapte à orienter vers l’Église « les affections refoulées par le célibat16 », il la force à se donner à lui. En revanche, elle a exigé qu’il disparaisse de sa vie pour toujours. Néanmoins, un an plus tard, Julien cherche à revoir Lydia, sans savoir si ce qui le guide est « la jalousie du présent, ou le remords du passé17 ». Il la trouve chez elle sur le point de mourir des suites d’un avortement qu’elle s’est imposé. Il comprend aussi, à ce moment-là, que Lydia l’avait aimé et qu’il était passé à côté d’un amour qui aurait pu donner un sens à sa vie.
La mort de Lydia agit profondément sur Julien ; elle lui donne enfin ce qu’il ne savait trouver, ce qu’il avait cherché en vain et à tort auprès de l’expérience des religions populaires : une âme. Cette âme lui permet dès lors de rejoindre l’humanité souffrante : « Jamais il ne s’était senti moins seul ; une présence universelle l’entourait, la conscience d’une souffrance humble et nécessaire, qui rachetait l’ignominie et l’aveuglément des gens heureux18 ». La leçon à laquelle conduit le parcours de Julien est donc tragique : il aura fallu la honte de soi et l’ignominie de son propre comportement assassin pour rendre à l’être humain un peu de sa propre vérité. Cette leçon paraît sans rémission, puisque seule la responsabilité de la mort de l’autre, et donc la souffrance que cette situation engendre, conduisent à l’âme. Julien Lepers apprend ainsi, brutalement et dans la douleur, que les possibilités de l’âme ne sont pas plus du côté de la bourgeoisie que dans l’ésotérisme ou l’antoinisme, « une religion faite pour les pauvres et les infirmes19 », mais qu’elles seront plutôt à saisir dans une attitude humble envers la vie, dans une disposition d’esprit qui témoigne que seule la souffrance, dans un monde sans amour, peut venger les humiliés de l’existence. C’est ce que Julien découvre au terme d’une aventure qui l’a mené à une sorte de renoncement définitif et de pessimisme intégral. C’est par ce déplacement de l’âme religieuse (Huysmans) vers l’âme de cœur, si l’on peut dire, et qui n’est accessible qu’à la conscience souffrante, que Thérive fait du roman populiste. Mais ce populisme est profondément désespéré, comme on l’a souligné20.François Ouellet, Le « naturalisme interne » d’André Thérive
Études littéraires – Volume 44 No 2 – Été 2013, 19–36.
https://doi.org/10.7202/1023748ar1. Joris-Karl Huysmans, En route, Paris, Plon, 1947 [1895], p. 153.
2. Ibid., p. 139.
3. Ibid., p. 140.
4. Henri Martineau, « André Thérive : Sans âme », Le Divan, 1928, p. 132. Même commentaire de François Le Grix dans La Revue hebdomadaire : « N’est-ce pas en vertu d’un hasard étonnant, et même arbitraire, que Julien Lepers, où qu’il se tourne, se cogne à des antoinistes, comme si c’était, en notre temps, la seule forme de l’aberration religieuse ? » (« Sans âme, par André Thérive », op. cit., p. 632).
5. « Son livre est une réussite, et non seulement par le style qui reproduit à s’y méprendre celui du XVIIe siècle, mais par l’intelligence d’une des époques de notre histoire où l’inquiétude religieuse se manifesta avec tant d’âpreté. Cette inquiétude M. Thérive la partage-t-il ? Il n’y paraît pas, encore que l’on sache quel intérêt il porte à l’hérésie, en général, et singulièrement aux déviations de la mystique » (John Charpentier, « André Thérive : Le Troupeau galeux », Mercure de France, 15 décembre 1934, p. 578).
6. Joris-Karl Huysmans, En route, op. cit., p. 45.
7. Ibid., p. 29.
8. Id.
9. Ibid., p. 163.
10. Voir le fameux texte de Marcel Arland, « Sur un nouveau mal du siècle » : « Mais un esprit où cette destruction de Dieu est accomplie, où le problème divin n’est plus débattu, par quoi comblera-t-il le vide laissé en lui et que maintient béant la puissance des siècles et des instincts ? » (« Sur un nouveau mal du siècle », La Nouvelle revue française, février 1924, p. 157).
11. Voir les essais de Daniel-Rops (Notre inquiétude, 1927) et de Benjamin Crémieux (Inquiétude et reconstruction, 1931). Crémieux fait cette distinction intéressante : alors que les jeunes gens de 1825 étaient des « inadaptés sociaux », ceux de 1920 sont des « inadaptés métaphysiques » (Inquiétude et reconstruction, Paris, Gallimard (Les Cahiers de la NRF), 2011, p. 90-91).
12. Joris-Karl Huysmans, En route, op. cit., p. 93.
13. Davidou, un ami et collègue de Julien au Laboratoire, expose ainsi le paradoxe de leur situation : « Moi je trouve ça grotesque ; nous autres qui avons la formation positive, nous devons étudier les formes religieuses qui ont de la spiritualité, qui recouvrent des approximations du réel social » (André Thérive, Sans âme, Paris, Grasset, 1928, p. 123).
14. Ibid., p. 109-110
15. Ibid., p. 149
16. Joris-Karl Huysmans, En route, op. cit., p. 73.
17. André Thérive, Sans âme, op. cit., p. 160.
18. Ibid., p. 189.
19. Ibid., p. 97.
20. « La fleur se dégage ici du fumier, peut-être pas avec assez d’élan, à mon gré ; et l’on reste, le livre de M. Thérive fermé, sur une impression bien pessimiste — je dirais même désespéré » (John Charpentier, « André Thérive : Sans âme », Mercure de France, 1er avril 1928, p. 147). Sans âme révèle « le nihilisme de l’écrivain qui porta Schopenhauer dans sa musette pendant quatre années de guerre » (Henri Clouard, Histoire de la littérature française, Du symbolisme à nos jours, Paris, Albin Michel, 1949, t. 2, p. 388). votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 16 Avril 2019 à 11:50
Auteur : Pierre Bathille
Titre : L'Œuvre d'André Thérive
Éditions : Chroniques, in Spetentrion, 1930, p.361-368 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 15 Avril 2019 à 17:18
Auteur : André Thérive
Titre : Entours de la foi
Éditions : Grasset, Paris, 1966Évoque comment certains personnages de l'église ont considéré les Antoinistes : le Père Valensin (prêtre jésuite) qui déclara qu'il "y a des âmes admirables et que Dieu aime autour de vous parmi les hindous, les musulmans, les luthériens et les antoinistes" et Raoul Stéphan (historien du protestantisme) qui considère le mouvement du Père Antoine comme faisant parti des "dissidence et extravagances analogues dans l'Eglise romaine".
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 18 Mars 2019 à 16:17
La Chronique des Livres
André THÉRIVE : SANS AME
On comprendrait mal ce livre, et on ne le placerait pas à son rang, si l'on y cherchait seulement la peinture réaliste des tristes et grouillantes régions de la Glacière ou de la Butte-aux-Cailles, et l'étude de cette population tapie dans sa misère, d'où les fillettes s'évadent, lorsqu'elles le peuvent, vers les studios de cinéma ou les coulisses des cafés-concerts. Ce n'est pas là, pourtant, un simple décor, et je ne prétends pas en diminuer la portée. L'atmosphère de ce quartier parisien forme comme le climat de l'œuvre, et les êtres qui se développent dans cette sombre lumière en conservent dans l'âme les teintes blêmes et douloureuses. Toute cette partie descriptive est donc fort importante, avec ses prolongements dans tous les milieux où les personnages nous font pénétrer à leur suite. L'auteur se fût-il borné à tracer ces tableaux que son livre eût encore, je crois, charmé Huysmans par l'âpreté avec laquelle il nous dépeint cette frange lépreuse de la ville éclatante, cette zone maudite qui n'est ni campagne ni cité, cette hideur si atroce qu'elle atteint à la grandeur et à la poésie à force d'abjection et d'inhumanité.
J'ajouterai qu'un des éléments du talent de Thérive est précisément ce don d'observation concrète qui lui permet de placer ses héros, avec une exactitude évocatrice, dans l'ensemble des formes extérieures parmi lesquelles ils se meuvent ; non pas à la façon de Zola, qui, procédant par accumulation et énumération, exige de ses lecteurs qu'ils construisent eux-mêmes, avec les matériaux qu'il leur fournit, le tableau qu'il n'a pas composé ; mais en réaliste classique, pour qui l'expression de la vérité, si stricte soit-elle, ne va pas sans interprétation, et qui nous la fait voir moins par des traits matériels qu'en éveillant en nous les émotions et les impressions que son spectacle a suscitées en lui. Il y a là une forme d'imagination à la fois réceptive et créatrice, une sorte de plaque sensible consciente de sa sensibilité, une tendresse et une pitié secrètes qui, sans s'exprimer, communiquent leur frémissement à la peinture et la rendent plus émouvante pour nous que ne serait la réalité.
Notons aussi, dans cette œuvre, une science des âmes sur laquelle, pourtant, j'insisterai moins, car elle n'est pas, selon moi, la qualité la plus rare d'un romancier : quiconque fait métier de nous étaler notre cour doit évidemment le connaître, et, pour lui en faire un compliment, il faut vivre en ce temps singulier où l'on voit des écrivains dépourvus, tout à la fois, d'imagination, de sensibilité, de psychologie, et de syntaxe.
Ces qualités, Thérive les possède éminemment, et il y joint une anxiété métaphysique qui en augmente infiniment la puissance et la portée. La véritable beauté de son livre, et ce qui, à mon avis, le place si haut dans la production moderne, c'est qu'il est un des cris les plus désespérés qu'ait poussés l'angoisse humaine.
Julien Lepers – le principal personnage – est un bourgeois évadé de la bourgeoisie, un intellectuel indolent, attiré par la bohème, un contemplateur pour qui comptent peu les nécessités de la vie quotidienne, un solitaire que la solitude épouvante. Livré à ses instincts, à ses impulsions, à cette fatalité interne par laquelle nous avons remplacé l'antique ananké, il joue son existence plus qu'il ne la vit ; elle est pour lui une expérience à laquelle il assiste sans avoir le pouvoir, ni le désir de la conduire et de la modifier ; et, parce qu'il y a en lui deux tendances, il oscille, instable, attiré tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, incapable de choisir, impuissant à se fixer.
Un certain type de femme exerce sur lui une emprise tyrannique. Il ne lui demande pas la beauté, mais quelque chose de plus mystérieux ; ce signe sexuel auquel il reconnaît que sa chair a besoin d'elle. Lucette, une humble ouvrière qui a quitté son gagne-pain pour un métier plus facile, pénètre ainsi dans sa destinée ; et, sans amour véritable, c'est pour lui, tout aussitôt, cet asservissement sensuel contre lequel, parfois, il se révolte, auquel pourtant il se soumet avez une fureur désespérée. Mais, obscurs, indéfinissables, ardents aussi, subsistent en lui d'inconscients besoins d'union spirituelle et de pureté. Une figurante de music-hall lui révélera les régions de l'âme autour desquelles il rôde, et qu'il entrevoit sans en trouver l'accès : Lydia, petit être étrange et violent, que la souffrance a bien armée, qui sait cacher sa pensée profonde, sa sensibilité, sa faiblesse, d'autant plus dure envers l'homme, qu'elle se sent plus près d'aimer.
Un jour, pourtant, elle cède à Julien, parce qu'elle est à bout de forces, qu'elle ne peut plus lutter - et qu'elle l'aime silencieusement. Et lui, qui ne sait pas, qui ne comprend pas, que son âme seule tend à la possession de cette âme, lui qui s'abandonne à un illusoire désir charnel, par habitude, par orgueil, par aveuglement, il accepte la condition que Lydia lui impose :
« – Aussi vrai que nous sommes ici, je vous jure que si je vous cède je ne vous reverrai plus jamais ensuite.
« C'était un marché bizarre, mais sincère. Il l'accepta cruellement. Il chercha cette bouche glacée. Elle avait les yeux pleins de larmes...
« Au matin, elle ne lui adressa pas la parole ; la rue Saint-André-des-Arts frémissait, jusque dans l'escalier pavé de briques. Elle se laissa embrasser sur la joue, et dit enfin :
« – Adieu ; c'était convenu. Pas au revoir ; adieu.
« Et c'est alors que, resté seul, il se réveilla tout à fait. Hélas ! il n'avait pas le don des larmes ! »
Lydia tient parole : Julien ne la voit plus. Lorsqu'il est privé d'elle, il est désemparé, détaché de tout, errant et vide : la perdu ce qui l'arrachait à la terre. Il ne reverra plus Lydia que mourante – assassinée par lui – puisqu'il l'a rendue mère et qu'elle expire en se délivrant, (la scène est atroce, et d'une déchirante beauté), et il apprend alors qu'il était aimé.
Qu'a-t-elle donc fait sur terre, cette petite créature au cœur craintif, au visage fermé ? Pourquoi ces élans vers un ciel muet, ces souffrances sans merci, ce destin sans lumière ?... Et tous les pauvres gens qui peuplent ce quartier d'infortune, ceux que connaît Lydia, ceux que connaît Lucette, tous ces vieux dont l'existence au fond des bouges est une ténébreuse agonie, qu'attendent-ils au cours de leur vie ? Comment en supportent-ils le poids ? Rien ne leur est concédé, ni les joies de l'esprit, ni les plaisirs du corps. A quelles illusions vont-ils s'accrocher ? Un obscur mysticisme fermente dans ces pensées confuses. A ceux qui n'ont rien sur terre, il faut une certitude plus haute, il faut un Dieu, mais un Dieu à leur mesure, à leur portée, immédiat, saisissable, presque visible. En marge du catholicisme, des sectes se forment donc, qui sont les étranges fleurs spirituelles de la zone et des impasses maudites ; l'antoinisme, avec ses affirmations massives, sa complaisance pour toutes les crédulités, son culte facile, ses miracles, se propage de ruelle en ruelle. Idolâtrie, superstition, mensonge, qu'importe ?... Toute cette humanité déchue, ces vieillards infirmes, ces femmes épuisées, ces frêles fillettes qui passent du ruisseau aux splendeurs du music-hall, et dont le cœur corrompu garde ses candeurs d'enfance, toute cette chair humaine, chair à supplices, chair à plaisir, toute cette chair sans âme est travaillée d'un désir, ardent : elle veut savoir, elle veut croire ; elle demande à connaître les raisons de sa présence sur terre ; elle exige la rançon de ses douleurs ; et elle tend vers un Dieu des mains tâtonnantes.
Il y a là un pessimisme si profond, et d'un accent si sincère, si frémissant, que la lecture de cet ouvrage, à laquelle on ne peut s'arracher, laisse une impression d'écrasante tristesse. Car cette misère, non pas seulement physique, mais métaphysique, cette ignorance de nos origines et de nos fins, cette universelle tyrannie de la souffrance, cette épouvante du néant qui nous attend peut-être, et dont nous avons la terreur malgré les cruautés d'une vie que nous n'avons pas souhaitée, ce sentiment que nous, les hommes, tous a les hommes, poursuivis pour un crime inconnu, nous sommes des condamnés à mort, ce n'est pas la torture des plus déshérités, c'est la torture de tous ; et qui sait si elle n'est pas plus tragique lorsqu'elle devient plus consciente ? Je crois, pour ma part, que la culture et la pratique de la pensée lui communiquent une incomparable acuité. Je n'en veux d'autre témoignage que ce livre même. Ce n'est pas seulement le roman de quelques déshérités, c'est aussi, (j'outrepasse peut-être les droits de la critique en le notant, mais rien n'ébranlera en moi cette certitude), c'est une confession. Et c'est bien ce qui le rend si violemment dramatique, et ce qui lui donne ce ton de vérité vivante. Pour apercevoir, dans ces larves humaines grouillantes au fond des bouges, dans cette population « sans âme », tout ce qui se dissimule d'appétits spirituels, pour être poursuivi, devant toute créature, par cette hantise de la souffrance, de la vieillesse, de la mort, il faut un peu plus que l'observation et l'interprétation du monde extérieur : il faut une pensée travaillée sans cesse de ces obscurs et terribles problèmes, et qui, en s'exprimant, tente de se délivrer. Y parvient-elle, en prêtant à la souffrance une valeur de rachat, ou n'est-ce pas la dernière illusion à laquelle elle s'attache pour ne pas s'abîmer dans un désespoir sans retour ?
« Jamais il ne s'était senti moins seul : une présence universelle l'entourait, la conscience d'une souffrance humble et nécessaire, qui rachetait l'ignominie et l'aveuglement des gens heureux. Cette conscience ne prenait pas de voix ni de nom. Elle ramenait peut-être à l'existence des foules innombrables de femmes, avilies, opprimées, des légions de pauvres gens que la mort a vengés de la vie, et à qui elle a restitué leur âme... Vilenies, illusions, esclavage qui ressemble à la liberté, combien de temps vous subir encore avant de voir ce que voient les yeux fermés sous l'océan de la terre, de regarder face à face une âme clémente et joyeuse qui lui aura pardonné ?... »
Hélas ! ce cri d'espoir n'est encore qu'un cri de désir : mais nulle réponse ne lui est donnée ! D'un bout à l'autre du livre, c'est la même angoisse, la même interrogation jetée au ciel muet. Ainsi nous sommes emportés sur un plan de pensée auquel le roman n'a pas coutume de s'élever. Celui-ci y parvient, et s'y maintient, sans perdre jamais son étroit contact avec la vie ; il extrait de la plus humble réalité toute sa signification spirituelle : c'est assez dire sa puissance et son originalité.Auguste BAILLY.
Candide, 23 février 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 14 Mars 2019 à 12:14
D'une couleur que l'auteur, également, a voulue grise et morne, le roman de M. André Thérive : Sans âme (1). Si ce livre présente de l'intérêt par certains passages, en tout cas le sens général qui l'anime, à en croire la notice de publicité qui – l'accompagne, n'a rien qui puisse nous le rendre sympathique.
M. André Thérive a voulu, paraît-il, décrire « les peuples des villes à qui on a enlevé toute vie religieuse et morale ». Il paraît que les misères morales et physiques dont Sans âme nous donne l'image viennent de l'abandon des principes religieux et moraux !
La lecture de ce livre ne nous a pas amené à pareilles conclusions, et nous ne voyons pas en quoi le déclassé Julien Lepers, l'ouvrière Lucette, la danseuse Lydia, qui sont les personnages du roman soient plus particulièrement privés d' « âme ».
Julien Lepers est préparateur dans un vague laboratoire de « physiologie des religions » sous la direction d'un professeur, M. Comte, sorte de « savant » hypocrite et pince-sans-rire, dont les cours n'ont pas d'auditeurs.
Julien passe son temps à errer mélancoliquement dans les rues tristes du quartier d'Italie, où il rencontre un soir, dans un cinéma, l'ouvrière Lucette ; les deux jeunes gens, désormais, vivent ensemble ; le frère de Lucette et ses amis forment le monde où vivra désormais Julien qui s'initie ainsi à ce qui, pour M. André Thérive, doit être la « vie populaire » : description littéraire de bars, bistrots, bals musettes, promenades à la campagne.
Cependant, la tristesse de ces quartiers ouvriers, aux rues d’usines et d'hôpitaux, et de taudis, la vie étrange de certaines… « sectes » comme celle des Antoinistes – est tendue d'une façon assez pénétrante.
Peu à peu, Julien pénètre dans d'autres milieux, devient l'amant de la danseuse Lydia, l'ami de Lucette, et cela nous vaut une description de « coulisses » de music-hall, où l'on voit le travail exténuant des danseuses et des figurantes, Lydia meurt tragiquement ; seule dans une chambre d'hôtel, tandis que Julien arrive pour assister à ses derniers moments.
Entre temps, l'on nous présente aussi une famille cagote et bien pensante de province, les de Gouin ; la mère gouverne les deux filles dans la religion, et le père, respectueux des croyances, regarde cette pieuse éducation avec tendresse, et va faire la noce à Paris. Il y a là évidemment une peinture assez vigoureuse de l'hypocrisie des familles bien pensantes – mais est-ce cette religion-là dont M. Thérive déplore l'abandon par le peuple ?
Bref, on ne voit pas très bien, dans toutes ces images qui se succèdent, où veut en venir M. Thérive. Du peuple, il n'a eu qu'une vision superficielle ; il a voulu représenter le déséquilibre et l'angoisse de certaines âmes jetées dans le tumulte de la vie moderne, et qui traînent leur « mal de vivre » et leur mélancolie dans une vie sans but. Et cela pour nous proposer, vraisemblablement, le refuge douillet et digestif de croyances mortes et de disciplines périmées.GEORGES ALTMAN.
(1) Grasset, éditeur.
L'Humanité, 5 février 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 20 Février 2019 à 16:01
OU M. ANDRE THERIVE
PARLE DU « POPULISME »M. Charles Chassé publie dans le Bulletin du livre français, un long article sur André Thérive. Cet article se termine en interview, et André Thérive parle des influences qu’il a subies et des « négatives » doctrines de populisme :
— Quelles influences littéraires avez-vous conscience d’avoir subies ?
— Celle des écrivains réalistes : Maupassant, Zola (j’écris pour une collection du Trianon une réception de Zola à l’Académie) mais particulièrement Huysmans. Cette influence de Huysmans est surtout sensible dans l’Expatrié. Dans ma jeunesse, j’ai beaucoup lu Anatole France et Moréas. Mais je me dois surtout, incontestablement aux écrivains réalistes et naturalistes. Aujourd’hui, parmi les œuvres qui me sont les plus sympathiques, je vous citerai les livres de Duhamel et les Thibaud de Martin du Gard.
— Ah ! Ah ! nous en venons au populisme !
— Si vous voulez. Il est certain que beaucoup de livres, parus au cours de ces dernières années ne m’ont pas enthousiasmé et je constate avec plaisir que lecteurs comme auteurs se détachent maintenant de la littérature soi-disant moderniste, celle dont on n’arrive pas à comprendre le sens.
— Et quelle est la doctrine populiste ?
— Il n’y a pas de doctrine populiste ou, si vous préférez, la doctrine populiste est purement négative. Nous sommes plusieurs qui pensons que les romans doivent être de préférence sociaux et qu’il est plus sain d’étudier l’homme de la rue que de se livrer à des recherches de psychologie précieuse et morbide. Une chose que je peux vous dire c’est que j’ai horreur de l’homme de lettres héros de roman. Remarquez que je ne tiens pas du tout au mot : populisme, je préférerais, le mot : socialiste, s’il n’avait, pas été accaparé par la politique, s’il était encore vierge. Ce qu’il ne faut pas, c’est que le romancier examine la psychologie d’un individu, sans tenir compte de la profession qu’il exerce, du groupe social auquel il appartient. Le roman d’amour est insupportable s’il n’est que roman d’amour, si l’amour qu’on y dépeint n’est pas lié à des questions sociales ou religieuses. (Tenez ! les petites religions, comme l’Antoinisme, m’ont beaucoup intéressé).Comoedia, 12 mai 1932
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 25 Octobre 2018 à 10:26
POUR LA CHRONIQUE DU POPULISME
par DANIEL-ROPSIl n’y a pas encore un an qu’est né le Populisme, puisque c’est le 27 août dernier que l’Œuvre publia le manifeste de MM. Lemonnier et Thérive. Est-ce là un recul suffisant pour décider si le mot et l’école ont atteint la gloire ? Evidemment non ; il faut attendre que se produise une décantation, après le bouillonnement de l’expérience. Mais qu’il y ait déjà une réussite, cela me paraît certain. Le père du populisme, M. Lemonnier, le constatait récemment dans les Nouvelles Littéraires. « Le mot populiste a fait fortune. Il appartient maintenant au langage de la critique... Son sens s’enrichit et se précise à mesure que les œuvres viennent renforcer le mouvement. Le mot est même en train de s’étendre aux autres arts, et on commence à parler de peinture populiste. Mieux encore, il est presque d’usage courant et s’applique à la vie même ; j’ai entendu parler de scènes populistes. » Voilà qui est parfait ; à ce compte, l’école est lancée. D’ailleurs des discussions qui ne laissent point d’être passionnées ne se sont-elles pas engagées à son sujet ? N’a-t-on pas suspecté le populisme de noirs desseins politiques ? Bon signe de gloire. Toute école littéraire en vedette suscite volontiers, parmi les historiens des lettres, des commentaires : tâche modeste, qui sera la mienne aujourd’hui.
D’abord une contribution aux sources. En exposant, dans l’Europe centrale, les origines et le programme de la nouvelle école, M. André Thérive a écrit ceci : « Nul ne peut se vanter d’avoir découvert un terme à la fois vierge et frappant. Celui de populisme a été, si je ne me trompe, déniché par Léon Lemonnier dans le vocabulaire politique... ». Ces mots font allusion, sans doute, au parti allemand dit populiste, et dans cette acception le mot est assez récent. Mais l’histoire littéraire pourra découvrir d’autres sources, et plus curieuses. Je ne veux pas dire que M. Lemonnier ait eu connaissance des textes que je vais citer ; quand un mot ou une doctrine réussissent, il se produit un phénomène tout semblable à celui que les géographes appellent « érosion régressive ». Par le mot ou par la doctrine, on interprète des œuvres antérieures, et qui se trouvent éclaircies ainsi d’un jour nouveau. On l’a bien vu quand le Freudisme se répandit dans nos lettres !
Le hasard, donc, m’a fait retrouver un texte fort ignoré dans lequel le mot populisme figure en toutes lettres et à peu près utilisé dans le sens même que lui accordent nos populistes d’aujourd’hui. Et ce texte date de 1897, époque où MM. Lemonnier et Thérive étaient encore sur les bancs du collège. Il s’agit d’une brochure de M. Paul Crouzet (qui était alors jeune professeur au lycée de Toulouse) intitulée Littérature et conférences populaires (Armand Colin, éditeur). Après avoir exposé comment et pourquoi l’on devait faire des conférences populaires, M. Crouzet envisageait les conséquences que pouvait avoir un vaste mouvement des intellectuels vers le peuple. 1897, Michelet, Tolstoï... Voici comment M. Crouzet définit cette littérature qui, selon lui, exprimerait le génie du Populisme (1) :
« Pas plus qu’il ne se ravalera aux basses œuvres littéraires, à l’excitation des grossiers instincts ou à la recherche des gros effets l’artiste populaire ne peut prétendre rivaliser avec les virtuosités et les raffinements des dilettanti. Son esprit aussi juste que simple fera bonne et prompte justice des subtiles complexités ou des fictions trop savantes qui sont d’ailleurs les signes d’un art en décadence. L’art populaire, au contraire, vivra en pleine vigueur, guéri des névroses et des neurasthénies, des morbidesses et des « rosseries ». Le peuple n’aura pas le « trop d’esprit qui gâte », mais il en aura assez pour que l’art, confiant en lui, ne soit plus réduit à cette alternative : se galvauder ou se cloîtrer... Son principal souci sera d’être homme et de parler à des hommes. »
Je ne sais si les populistes d’aujourd’hui contresigneraient volontiers ces déclarations populistes d’hier ; elles portent la marque de leur temps. Au moins dans leurs grandes lignes, ces déclarations coïncident avec celles de M. Lemonnier, mais en mettant l’accent beaucoup plus sur le côté social que sur le côté psychologique de l’expérience ainsi proposée. Si je comprends bien, M. Crouzet incitait à aller au peuple pour en relever la culture, pour l’intégrer au public cultivé ; M. Lemonnier a un dessein beaucoup plus esthétique et cherche surtout à utiliser le peuple comme modèle, comme donnée artistique. Lorsqu’il écrit, par exemple, qu’on doit tenir pour populiste : « toute œuvre traitant du peuple, dans quelque esprit que ce soit, et d’autre part tout livre qui paraît, à certains égards, continuer la tradition réaliste », il limite, socialement parlant, la portée de sa doctrine. Et c’est d’ailleurs un des problèmes essentiels qui se posent à propos de cette nouvelle école que celui de ses rapports avec le peuple.Comment peut-on envisager les relations du romancier populiste avec le peuple ? On peut d’abord les nier, en déclarant que le peuple, cela n’existe pas. Soit. Mais que devient le populisme ? Au surplus, il serait vraiment trop simple de tenir Caliban pour un mythe. Le peuple existe, si peu tranchées que soient ses limites. Admettons qu’il y a des échelles, des nuances, mais la notion n’en est pas moins très nette.
Sera-ce seulement un modèle ? M. Jean Guéhenno, dans Europe, a protesté assez âprement contre cette curiosité qui tend à considérer Caliban comme le monstre, qu’on observe, qu’on dépeint. Les Concourt le disaient nettement : « Le peuple, la canaille, si vous voulez, a pour moi l’attrait de populations inconnues... quelque chose de l’exotique.... » Je crois qu’il y a un peu de cela dans je populisme, non exprimé avec ce cynisme, mais à l’état larvé, et mêlé à une très réelle générosité. Car je ne crois pas du tout, comme on l’a insinué, que les populistes cherchent à donner à leurs livres le piquant de l’exotisme ; je sais que leur but est plus haut et que, dégoûtés des cénacles, ils cherchent surtout à renouveler la matière littéraire en puisant largement dans l’humain, dans ce que l’homme a de plus spontané. Et là M. Jean Guéhenno se trompe quand il imagine là protestation du peuple : « N’aurez-vous pas bientôt fini de me traiter comme un monstre ? » Non, il ne s’agit pas de cela. Mais je crois que déjà la mésentente est établie et que le peuple risque de se méfier du populisme.
Reste, un autre aspect de la question. La littérature populiste s’adresse-t-elle au peuple ? Autrement dit, modèle des livres populistes, le peuple en sera-t-il le client ? M. Paul Crouzet, dans sa brochure, rapporte une, étonnante page de Faguet où le critiqué annonçait que, vers 1950, il y aurait « comme un divorce entre le petit groupe des intellectuels et la foule. Quelques livres très pensés, très scientifiques et très littéraires, très peu achetés... que la foule ignorera... très loin au-dessous, le journal populaire ». Eh bien ! ce fossé dont s’effrayait Michelet, le populisme pourra-t-il le combler ? J’aimerais qu’un des chefs du populisme nous donnât son avis sur ce point. Pour ma part je suis assez pessimiste. Je ne crois pas que ce fossé puisse être comblé par la volonté des littérateurs. Les expériences faites jusqu’à aujourd’hui sont peu concluantes. Je crois plutôt que ce fossé se trouvera comblé de lui-même le jour où la diminution du travail (conséquence du développement du machinisme, lequel pourra être un remède après avoir été un fléau) permettra à chacun de lire, de réfléchir. Si toutefois le cinéma, parlant ou non, n’a pas d’ici là définitivement gâté les meilleurs cerveaux.
Un point qui m’intéresse particulièrement dans le populisme tel qu’il se présente aujourd’hui à nos yeux, est le rôle que le mysticisme y joue. M. Lemonnier a dit nettement que les populistes, en cela, auraient à s’écarter des nationalistes. Les romans de M. Thérive : Sans âme, Le Charbon ardent, prouvent assez qu’on peut tirer de beaux livres du mysticisme chez le peuple. Mais je suis très préoccupé de savoir si les cas qui nous sont présentés sont autre chose que des exceptions. Jusqu’ici, aucun populiste ne nous a montré de mysticisme religieux normal : nul n’a traité, par exemple, la situation du catholicisme dans le peuple. Si les populistes procèdent de Huysmans (beaucoup plus que de Zola) c’est surtout à Là-Bas qu’ils se réfèrent, et non aux livres catholiques. Un Jean Soreau — ou des Antoinistes — ce n’est pas la généralité. Que valent alors ces témoignages pour l’ensemble ? J’aimerais qu’un homme ayant l’expérience directe du peuple, un Robert Garric, par exemple, nous en pariât. M. Jean Guéhenno lui, est formel. Tout en louant hautement M. Thérive d’avoir montré l’existence du « secret » dans un cœur populaire, il conclut : « L’esprit du peuple ne rôde plus autour des églises. Sa flamme la plus vive jaillit ailleurs. Les grands drames populaires ne sont pas des drames huysmansiens. Si M. Thérive est vraiment curieux, de l’âme populaire, le sujet qu’il ne pourra manquer de rencontrer, c’est celui même de la Révolution ». Et avec ce mot nous nous heurtons à un autre problème.
Au fond, si j’estime le populisme et si j’aime cette tentative pour donner de l’air à notre littérature, je ne crois pas du tout que le peuple ait à y gagner. Caliban est muet ; que l’observateur sorte de sa masse ou qu’il vienne du dehors, j’ai toujours la crainte que, par !e seul fait qu’il exprime, il fausse la règle du jeu et déforme le réel, l’inexprimable.DANIEL-ROPS.
(1) M. Crouzet ajoute en note : « Nous ne sommes pas, en France, habitués à ce mot, très employé en Amérique ; il me paraît avoir l’avantage d’être très expressif et de n’inféoder la littérature populaire à aucun des partis déjà classés en France ». Voilà qui réjouira MM. Thérive et Lemonnier.
L'Européen : hebdomadaire économique, artistique et littéraire, 2 avril 1930
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 25 Octobre 2018 à 09:53
Sous ce titre Sans Ame, M. André Thérive vient de publier un roman d’un caractère réaliste, sinon naturaliste, assez surprenant quand on sait les termes attaches classiques de cet écrivain. Mais voulant rendre sensibles son lecteur les effets du mal produit précisément par le désordre actuel, il a dû se placer au milieu même de l’incohérence consécutive à la rupture des cadres sans lesquels l’élément mystique, nécessaire à la vie des hommes devient un danger. Et c’est dans le peuple, non dans la société bourgeoise et mondaine qui peut encore faire illusion, qu’il est allé étudier la profonde misère morale de notre temps.
Roman de mœurs autant que roman psychologique, son récit, qui fait à la fois songer à Huysmans et à M. Georges Duhamel, se passe dans les faubourgs parisiens et, dans une louche atmosphère, évoque de bien curieux personnages, à la fois tourmentés d’inquiétudes charnelles et de spirituelles aspirations.
Julien Lepers, le héros de M. Thérive, un déclassé que ses goûts crapuleux ont entraîné vers la bohème plébéienne, est victime de cette contamination dont je parlais plus haut. Il cherche dans des aventures sans beauté, où il obéit au seul attrait des joies sensuelles, une ivresse qui le trompe sur le néant de sa pensée et de son cœur. Il s’acoquine avec une femme non seulement presque laide, mais dont la vulgarité l’humilie, et auprès d’une autre, qui éveille en lui de pures appétitions, pèche par libertinage contre la tendresse qu’il inspire.
Remarquons-le, car la chose a son originalité, ce n’est pas tant la disgrâce matérielle des gens qui évoluent autour de Julien que M. Thérive nous montre, et sur laquelle il insiste avec pitié. Si l’antoinisme dont il nous entretient (et qui est à la religion ce que les travaux du laboratoire où il nous introduit sont à la vraie science) recrute ses adeptes parmi des misérables éprouvés par les privations et les maladies, nous voyons que la consolation qu’il leur offre répond à un besoin d’amour et à un désir de certitude. Aussi bien, quoi d’autre que ce besoin et que ce désir dans la curiosité qui pousse Julien à se mêler aux réunions des adeptes du père Antoine, et à parler de l’enseignement de cet apôtre avec l’étrange petite danseuse Lydia qui le fait rêver d’un bonheur inconnu de lui ?
Naturaliste, le roman de M. Thérivè ne l’est donc qu’en fonction de la spiritualité qui l’inspire. La fleur se dégage ici du fumier, peut-être pas avec assez d’élan, à mon gré et l’on reste, le livre de M. Thérive fermé, sur une impression bien pessimiste – je dirai même désespérée. Mais la sincérité de l’auteur ne fait pas de doute. En elle réside le secret de la sympathie qu’il nous inspire pour ses personnages et pour son héros même, malgré qu’on en ait. Non que celui-ci lui ressemble ! Qu’il soit une manière de projection de son angoisse métaphysique, c’est assez pour qu’on puisse dire qu’il a été conçu sous le signe du lyrisme.Mercure de France, 1 avril 1928
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 25 Octobre 2018 à 09:40
Les Lettres.
Un roman d’André Thérive :
« Sans âme » (1)« Périphérie de la ville, périphérie des
sentiments et des croyances, vagabon-
dages excentriques en des lieux que nul
passé n’ennoblit de ses prestiges… »Un soir place d’Italie. Un homme est adossé à la grille du square il est venu là sans savoir où ses pas le portaient, désireux seulement de se fuir, de mettre le point final à quelque aventure dérisoire. Il guette, ses sens quêteurs une fois de plus se sont mis en chasse. Il rôde à présent autour de la place, enfile un boulevard désert, puis un autre. Il s’engouffre pour finir dans un cinéma de bas étage qu’achalandé un crime récent ; et c’est là qu’il surprend le gibier espéré. « Une femme en cheveux, assez mal peignée, dont la nuque maigre sortait d’un manteau de peluche, couleur de mousse jaune. » Une lèvre retroussée un menton lourd le signe purement physique du trouble et de la servitude. Il n’en faut pas davantage pour que Julien Lepers succombe cette fois encore à l’obsession charnelle. Il suit cette créature équivoque et sans beauté, il l’aborde. Elle se nomme Lucette, travaille dans une sucrerie ; il est attaché à un obscur laboratoire où un maniaque prend la tension artérielle et enregistre les réactions motrices de pauvres diables atteints de folie mystique. Ces fonctions mal rémunérées ne l’absorbent pas outre mesure, il a un oncle qui lui sert une pension. Quel homme est-ce que ce Julien, et qu’attend-il de cette Lucette dont il ne tarde pas à devenir l’amant ? M. Thérive trace de son héros un portrait d’une admirable vraisemblance. « S’il avait en lui un don singulier, c’était de se renier violemment, de détester ce qu’il était. Du mépris ? bien moins de la désaffection. De l’horreur c’est trop dire, de l’antipathie plutôt l’impression d’un servage mal choisi, au hasard quelque chose comme un mariage imposé par la faiblesse el dont on ne voit plus que la duperie. » Pour un homme de cette sorte, il n’est d’autre ressource que la duplicité et sans doute il n’a point de maître, point de famille, point de Dieu avec qui jouer à cache-cache mais il éprouve malgré tout un plaisir exquis à se cacher, à changer de goûts, de mœurs, de langage, d’âme, s’il se pouvait. Quitte à se ménager toujours une retraite vers le passé, qu’il serait si cruel de noyer de ses mains, d’enterrer à jamais. La conscience de Julien est le siège d’une lutte perpétuelle. Le goût fiévreux du renouvellement s’y allie à une craintive superstition du passé, à l’impossibilité de s’en délivrer jamais par un acte délibéré. Etre, continuer d’être, échapper à ce qui meurt tel est comme le noyau métaphysique d’une hantise qui déborde infiniment l’étroit chenal des sens. Nous touchons ici à ce qui confère au livre son pathétique et son originalité. Le reproche de naturalisme qu’on ne manquera pas de lui adresser porte, selon moi, entièrement à faux. Ce n’est pas parce qu’un écrivain nous promène à sa suite de la Maison-Blanche à la Glacière et à Vaugirard, à travers des quartiers sordides où se presse une foule interlope, qu’il souscrit nécessairement à une esthétique déterminée. Ce serait trop simple. Si l’on veut trouver un parrain à M. Thérive, c’est assurément à M. Duhamel, c’est-à-dire à un lyrique, qu’il convient de penser. J’aperçois chez l’un et l’autre un même souci de spiritualité, une même inquiétude en présence des confuses aspirations de l’homme, et surtout peut-être des réponses qu’une industrie verbale millénaire inventa pour les endormir. Mais peut-être y a-t-il une moindre complaisance, une nouvelle tendance à l’affranchissement chez M. Thérive, une ironie plus âpre et plus triste qui communique à son livre une saveur particulièrement tonique.
Lucette est « une femme de tête peu maîtresse du reste ». Intéressée sans être à proprement parler vénale, c’est une nerveuse instable qui dispose d’elle-même avec un singulier mélange de sens pratique et d’impulsivité : quelle que soit l’emprise physique qu’elle conserve sur Julien, elle ne saurait accaparer les rêves de cette âme vagabonde. Celle-ci s’évade sans cesse. Il y a autour de Lucette de petites gens qui végètent mélancoliquement et trouvent dans on ne sait quelles dévotions hétérodoxes l’anesthésique qui leur permet d’accepter sans révolte la déchéance physique et la mort. Il y a surtout Lydia, la cousine de Lucette, une petite danseuse au cœur farouche minée par la tuberculose. Une précoce expérience lui a enseigné à se méfier des hommes ; qui sait si les turpitudes qu’elle a frôlées ne sont pour rien dans l’attrait équivoque qu’elle exerce sur Julien ? Insensiblement sa pensée se divise entre ces deux femmes si inégalement marquées par la vie ; mais bien qu’il demeure soumis au magnétisme sexuel de Lucette, insensiblement c’est l’image de Lydia qui l’emporte, l’inconnu confusément pressenti que cette image recouvre. Un jour, cédant au mécanisme, il la somme de se donner à lui. Elle s’insurge contre une telle infraction au pacte tacite qui les liait. « Ecoutez bien, dit-elle, Aussi vrai que nous sommes ici, je jure que si je vous cède je ne vous reverrai jamais plus ensuite. » II s’obstine, non sans prendre, il est vrai, de sa bassesse la plus amère conscience. Elle cède, et s’enfuit au matin en lui disant adieu. « Et c’est alors que, resté seul, il se réveilla tout à fait. Hélas ! il n’avait pas le don des larmes. » D’abord il ne cherche pas à la revoir, il ne s’enquiert pas d’elle. Pourtant elle emplit sa pensée. Il ne fréquente plus que les endroits où elle a vécu et dont elle lui a parlé. Des mois se passent. Un jour, il n’y tient plus, et se rend au Palladium, somptueux music-hall de la rive droite, où Lydia a un engagement. Il apprend que la veille, un commencement d’incendie s’étant déclaré, le pied de Lydia s’est pris entre deux barreaux d’une échelle de sûreté ; elle s’est évanouie et au réveil se plaignait de douleurs internes. Julien court à son hôtel, frappe à la porte de sa chambre ; nulle réponse ; il entre. Elle est à l’agonie. Elle était enceinte et a eu un accident. Tous les jours elle attendait sa venue ; elle l’aimait. Il est trop tard. A peine aura-t-elle la force de murmurer avant de mourir une parole de pardon. Et maintenant qu’elle n’est plus, il s’interroge. « Jamais il ne s’était senti moins seul ; une présence universelle l’entourait, la conscience d’une souffrance humble et nécessaire qui rachetait l’ignominie et l’aveuglement des gens heureux. Cette conscience ne prenait pas de voix ni de nom. Elle ramenait peut-être à l’existence des foules innombrables de femmes avilies, opprimées, des légions de pauvres gens que la mort a vengés de la vie et à qui elle a restitué une âme. »Le livre de M. Thérive a, je le sais, de violents détracteurs, tout ce que je puis dire c’est qu’il m’a profondément remué et que je plains ceux qu’il laisse insensibles. L’odeur qui s’exhale de Sans Ame est celle même de la solitude et de l’angoisse. Un cœur pitoyable se montre ici à nous, se libérant au prix d’un effort des contraintes et des mensonges du respect humain…
Périphérie de la ville, périphérie des sentiments et des croyances, vagabondages excentriques en des lieux que nul passé n’ennoblit de ses prestiges…, et çà et là entre les pages du roman l’on voit briller les lueurs incertaines qu’allume la ferveur des hommes sur le pourtour misérable des cités sans mémoire.Gabriel MARCEL.
(1) Grasset, éd. (Collection Les Ecrits.)
L’Europe nouvelle, 28 janvier 1928
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
sur les traces d'un homme d'exception et de son universalisme philosophique...............Musée virtuel de l'Antoinisme