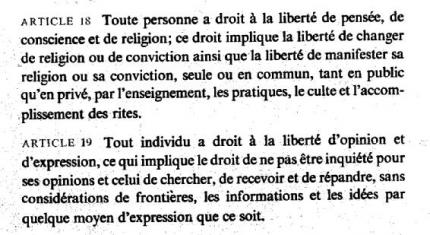-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:28
A chaque épreuve, un pas en avant.
Maxence van der Meersch, Corps et âmes, p.275
Le Livre de Poche, Paris, 1943 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:21
Lorsque l'argent est la seule raison de notre travail, il devient difficile d'estimer nos vrais besoins et d'apprécier ce qu'on possède déjà.
merci à Jacques Cécius pour cette citation du jour. votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:21
La langue des anges est évoquée par Saint Paul dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens :
« Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. »
Les anges, étant de purs esprits, n'ont pas besoin de langage pour communiquer les uns avec les autres. Les êtres humains communiquent avec des mots, qui sont des représentations symboliques de la pensée. Les êtres purement spirituels peuvent transmettre leurs pensées dans un état pur, sans besoin de médiation ou de signes (Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique, I. Frédérique Von Lama: Les Anges).
Dans la tradition islamique, et selon Ahmed Moubarek, dit 'Abd al-'Aziz al-Dabbagh, grand soufi illettré qui vécut à Fès à la fin du XVIe et au début du XVIIe, dans le Kitab-Al-Ibriz (traduction : Le Livre d'or pur), il existe une langue des anges et nommée langue « siryanîte », proche de la langue des oiseaux. Selon le poète soufi marocain, elle existe dans chaque langue et consiste en un autre sens que celui communiqué, le sens réel étant donné dans sa prononciation et non dans son écriture. C’est également la langue des grands saints. D'après une légende islamique, il y a des inscriptions en siryanî sur le tronc du ‘Arsh et sur la porte du Paradis, qui ont également le pouvoir de parler aux défunts dans la langue divine.Pour Ahmed Moubarek, le siryanî se trouve également dans les « lettres isolées » qui ouvrent les sourates du Coran et dont aucun théologien musulman n'a donné d'explication à ce jour, comme par exemple « Alif - Lâm - Mîm » qui ouvrent la sourate 2 « la Vache » (Al Baquara). Dans le Coran en effet le terme aç-çāffātest évoqué, désignant littéralement les oiseaux, mais comme s’appliquant symboliquement aux anges (al-malā’ikah) par proximité phonétique.
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_%28religion%29#Langue_des_anges votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:17
La pleine conscience (parfois également appelée attention juste, samma sati en sanscrit) est une expression dérivée de l’enseignement de Gautama Bouddha et désignant la conscience vigilante de ses propres pensées, actions et motivations. Elle joue un rôle primordial dans le bouddhisme où il est affirmé que la pleine conscience est un facteur essentiel pour la libération (Bodhi ou éveil spirituel).
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pleine_conscience votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:16
Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter.
Jean-Jacques Rousseau
merci à Jacques Cécius pour cette citation votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:13
Très souvent nous voudrions que notre vie ne soit qu'un rêve. Nous aimerions nous réveiller, comme dans les mauvais films, et résoudre tous nos problèmes par ce subterfuge. Dès qu'un personnage se noie au cinéma, youpi, il reprend conscience. Combien de fois avons-nous vu ça sur l'écran : le héros attaqué par un monstre gluant et carnivore, acculé au fond d'une impasse, qui, au moment où la terrifiante bestiole va la dévorer, paf, se redresse en sueur dans son plumard ? Pourquoi ça ne nous arrive jamais dans la vie ? Hein ?
Comment on peut se réveiller quand on ne dort pas ?
Frédéric Beigbeder, 99 francs, p.180
Folio, Paris, 2000 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:11
C’est une des formes les plus fréquentes de la dégénérescence mentale. Elle se manifeste surtout chez les femmes et chez des individus d’une culture intellectuelle un peu élevée.
Elle apparaît, souvent dès l’enfance sous forme de scrupules exagérés, au moment de la première communion surtout, de craintes puériles, non motivées. Le sujet a toujours peur de se tromper, recommence plusieurs fois ce qu’il fait, n’en est jamais content, et s’adresse toujours des reproches. Les moindres actes sont conçus avec mille précautions. Il n’est jamais sûr s’il a fait ou non une chose. Il est incapable de se décider à rien sans de nombreuses hésitations, et plus les choses sont de faible importance, plus son embarras paraît augmenter. Par contre il est souvent capable de très bien gérer des affaires importantes et dans dès moments difficiles de prendre une décision ferme et rapide.
Plus les occupations. du malade sont d’ordre intellectuel, et plus son angoisse se montre, à tout propos. Il en résulte un état général d’anxiété qui modifie son caractère et finit par le rendre quelquefois très difficile pour son entourage ; car il en arrive à douter, non seulement de ce qu’il fait, mais de ce que les autres font, et leur communique parfois ses hésitations et ses craintes perpétuelles.
Le doute est, tantôt d’ordre métaphysique et se rapporte aux problèmes de l’âme, de Dieu, de la nature, etc. ; tantôt d’ordre matériel et a pour objet les faits les plus simples de la vie journalière.
Des paroxysmes et des rémissions, de plusieurs années souvent, viennent modifier d’une façon irrégulière la marche de ces phénomènes.
Quelquefois le doute est tel qu’il cause au malade un état d’angoisse qui le fait tomber dans une sorte d’état mélancolique anxieux ou mystique, et que fréquemment apparaissent des idées de suicide qu’il met à exécution pour se débarrasser d’une existence trop pénible et d’une maladie dont il a conscience et qui n’est susceptible d’aucun traitement bien efficace.
source : http://www.psychanalyse-paris.com/+-Folie-du-doute-+.html votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:10
Jean-Louis Lacour a soixante-dix ans. Il est né à La Courteille, un hameau de cent cinquante habitants, perdu dans un pays de loups. En sa vie, il est allé une seule fois à Angers, qui se trouve à quinze lieues; mais il était si jeune qu’il ne se souvient plus. Il a eu trois enfants, deux fils, Antoine et Joseph, et une fille, Catherine. Celle-ci s’est mariée ; puis, son mari est mort, et elle est revenue chez son père, avec un petit de douze ans, Jacquinet. La famille vit sur cinq ou six arpents, juste assez de terre pour manger du pain et ne pas aller tout nu. Quand ils boivent un verre de vin, ils l’ont sué.
La Courteille est au fond d’un vallon, avec des bois de tous les côtés, qui l’enferment et la cachent. Il n’y a pas d’église, la commune est trop pauvre. C’est le curé des Cormiers qui vient dire la messe; et, comme on compte deux bonnes lieues de chemin, il ne vient que tous les quinze jours. Les maisons, une vingtaine de masures branlantes, sont jetées le long de la grand-route. Des poules grattent le fumier devant les portes. Lorsqu’un étranger passe, les femmes allongent la tête, tandis que les enfants, en train de se vautrer au soleil, se sauvent au milieu des bandes d’oies effarées.
Jamais Jean-Louis n’a été malade. Il est grand et noueux comme un chêne. Le soleil l’a séché, a cuit et fendu sa peau; et il a pris la couleur, la rudesse et le calme des arbres. En vieillissant, il a perdu sa langue. Il ne parle plus, trouvant ça inutile. D’un pas long et entêté, il marche, avec la force paisible des boeufs.
L’année dernière, il était encore plus vigoureux que ses fils, il réservait pour lui les grosses besognes, silencieux dans son champ, qui semblait le connaître et trembler. Mais, un jour, voici deux mois, ses membres ont craqué tout d’un coup; et il est resté deux heures en travers d’un sillon, ainsi qu’un tronc abattu. Le lendemain, il a voulu se remettre au travail; seulement, ses bras s’en étaient allés, la terre ne lui obéissait plus. Ses fils hochent la tête. Sa fille tâche de le retenir à la maison. Il s’obstine, et on le fait accompagner par Jacquinet, pour que l’enfant crie, si le grand-père tombe.
— Que fais-tu là, paresseux? demande Jean-Louis au gamin, qui ne le quitte pas. À ton âge, je gagnais mon pain.
— Grand-père, je vous garde, répond l’enfant.
Ce mot donne une secousse au vieillard. Il n’ajoute rien. Le soir, il se couche et ne se relève plus. Quand les fils et la fille vont aux champs, le lendemain, ils entrent voir le père, qu’ils n’entendent pas remuer. Ils le trouvent étendu sur son lit, les yeux ouverts, avec un air de réfléchir. Il a la peau si dure et si tannée, qu’on ne peut pas savoir seulement la couleur de sa maladie.
— Eh bien ? père, ça ne va donc pas ?
Il grogne, il dit non de la tête.
— Alors, vous ne venez pas, nous partons sans vous ?
Oui, il leur fait signe de partir sans lui. On a commencé la moisson, tous les bras sont nécessaires. Peut-être bien que, si l’on perdait une matinée, un orage brusque emporterait les gerbes. Jacquinet lui-même suit sa mère et ses oncles. Le père Lacour reste seul. Le soir, quand les enfants reviennent, il est à la même place, toujours sur le dos, les yeux ouverts, avec son air de réfléchir.
— Alors, père, ça ne va pas mieux ?
Non, ça ne va pas mieux. Il grogne, il branle la tête. Qu’est-ce qu’on pourrait bien lui faire ? Catherine a l’idée de mettre bouillir du vin avec des herbes; mais c’est trop fort, ça manque de le tuer. Joseph dit qu’on verra le lendemain, et tout le monde se couche.
Le lendemain, avant de partir pour la moisson, les fils et la fille restent un instant debout devant le lit. Décidément, le vieux est malade. Jamais il n’a vécu comme ça sur le dos. On devrait peut-être bien tout de même faire venir le médecin. L’ennui, c’est qu’il faut aller à Rougemont; six lieues pour aller, six lieues pour revenir, ça fait douze. On perdra tout un jour. Le vieux, qui écoute les enfants, s’agite et semble se fâcher. Il n’a pas besoin de médecin, ça ne sert à rien et ça coûte.
— Vous ne voulez pas ? demande Antoine. Alors, nous partons travailler ?
Sans doute, qu’ils partent travailler. Ils ne le soulageraient pas, bien sûr, en restant là. La terre a plus besoin d’être soignée que lui. Et trois jours se passent, les enfants vont chaque matin aux champs, Jean-Louis ne bouge point, tout seul, buvant à une cruche quand il a soif. Il est comme un de ces vieux chevaux qui tombent de fatigue dans un coin, et qu’on laisse mourir. Il a travaillé soixante ans, il peut bien s’en aller, puisqu’il n’est plus bon à rien, qu’à tenir de la place et à gêner le monde.
Les enfants eux-mêmes n’ont pas une grande douleur. La terre les a résignés à ces choses; ils sont trop près d’elle, pour lui en vouloir de reprendre le vieux. Un coup d’oeil le matin, un coup d’oeil le soir, ils ne peuvent pas faire davantage. Si le père s’en relevait tout de même, ça prouverait qu’il est rudement bâti. S’il meurt, c’est qu’il avait la mort dans le corps; et tout le monde sait que, lorsqu’on a la mort dans le corps, rien ne l’en déloge, pas plus les signes de croix que les médicaments. Une vache encore, ça se soigne.
Jean-Louis, le soir, interroge d’un regard les enfants sur la moisson. Quand il les entend compter les gerbes, se féliciter du beau temps qui favorise la besogne, il a une joie dans les yeux. Une fois encore, on parle d’aller chercher le médecin; mais le vieux s’emporte, et l’on craint de le tuer plus vite, si on le contrarie. Il fait seulement demander le garde champêtre, un ancien camarade. Le père Nicolas est son aîné, car il a eu soixante-quinze ans à la Chandeleur. Lui, reste droit comme un peuplier. Il vient et s’assoit près de Jean-Louis, d’un air sérieux. Jean-Louis qui ne peut plus parler, le regarde de ses petits yeux pâlis. Le père Nicolas le regarde aussi, n’ayant rien à lui dire. Et ces deux vieillards restent face à face pendant une heure, sans prononcer une parole, heureux de se voir, se rappelant sans doute des choses, bien loin, dans leurs jours d’autrefois. C’est ce soir-là que les enfants, au retour de la moisson, trouvent Jean-Louis, mort, étendu sur le dos, raide et les yeux en l’air.
Oui, le vieux est mort, sans remuer un membre. Il a soufflé son dernier souffle droit devant lui, une haleine de plus dans la vaste campagne. Comme les bêtes qui se cachent et se résignent, il n’a pas même dérangé un voisin, il a fait sa petite affaire tout seul.
— Le père est mort, dit Joseph, en appelant les autres.
Et tous, Antoine, Catherine, Jacquinet, répètent :
— Le père est mort.
Ça ne les étonne pas. Jacquinet allonge curieusement le cou, la femme tire son mouchoir, les deux garçons marchent sans rien dire, la face grave et blêmie sous le hâle. Il a tout de même joliment duré, il était solide, le vieux père! Cette idée console les enfants, ils sont fiers de la solidité de la famille.
La nuit, on veille le père jusqu’à onze heures, puis tout le monde cède au sommeil; et Jean-Louis dort seul encore, avec son visage fermé qui semble toujours réfléchir.
Dès le petit jour, Joseph part pour les Cormiers, afin d’avertir le curé. Cependant, comme il y a encore des gerbes à rentrer, Antoine et Catherine s’en vont tout de même aux champs le matin, en laissant le corps à la garde de Jacquinet. Le petit s’ennuie avec le vieux, qui ne remue seulement pas, et il sort par moments sur la route, lance des pierres aux moineaux, regarde un colporteur étalant des foulards devant deux voisines; puis, quand il se souvient du grand-père, il rentre vite, s’assure qu’il n’a point bougé, et s’échappe de nouveau pour voir deux chiens se battre.
Comme la porte reste ouverte, les poules entrent, se promènent tranquillement, en fouillant à coups de bec le sol battu. Un coq rouge se dresse sur ses pattes, allonge le cou, arrondit son oeil de braise, inquiet de ce corps dont il ne s’explique pas la présence; c’est un coq prudent et sagace, qui sait sans doute que le vieux n’a pas l’habitude de rester au lit après le soleil levé; et il finit par jeter son cri sonore de clairon, chantant la mort du vieux, tandis que les poules ressortent une à une, en gloussant et en piquant la terre.
Le curé des Cormiers ne peut venir qu’à cinq heures. Depuis le matin, on entend le charron qui scie du sapin et enfonce des clous. Ceux qui ignorent la nouvelle, disent : « Tiens ! c’est donc que Jean-Louis est mort », parce que les gens de La Courteille connaissent bien ces bruits-là.
Antoine et Catherine sont revenus, la moisson est terminée; ils ne peuvent pas dire qu’ils sont mécontents, car, depuis dix ans, le grain n’a pas été si beau.
Toute la famille attend le curé, on s’occupe pour prendre patience : Catherine met la soupe au feu, Joseph tire de l’eau, on envoie Jacquinet voir si le trou a été fait au cimetière. Enfin, à six heures seulement, le curé arrive. Il est dans une carriole, avec un gamin qui lui sert de clerc. Il descend devant la porte des Lacour, sort d’un journal son étole et son surplis; puis, il s’habille, en disant :
— Dépêchons-nous, il faut que je sois rentré à sept heures.
Pourtant, personne ne se presse. On est obligé d’aller chercher les deux voisins qui doivent porter le défunt sur la vieille civière de bois noir. Comme on va partir enfin, Jacquinet accourt et crie que le trou n’est pas fini, mais qu’on peut venir tout de même.
Alors, le prêtre marche le premier, en lisant du latin dans un livre. Le petit clerc qui le suit tient un vieux bénitier de cuivre bossué, dans lequel trempe un goupillon. C’est seulement au milieu du village qu’un autre enfant sort de la grange où l’on dit la messe tous les quinze jours, et prend la tête du cortège, avec une croix emmanchée au bout d’un bâton. La famille est derrière le corps; peu à peu, tous les gens du village se joignent à elle; une queue de galopins, nu-tête, débraillés, sans souliers, ferme la marche.
Le cimetière se trouve à l’autre bout de La Courteille. Aussi les deux voisins lâchent-ils la civière à trois reprises; ils soufflent, pendant que le convoi s’arrête; et l’on repart. On entend le piétinement des sabots sur la terre dure. Quand on arrive, le trou, en effet, n’est pas terminé; le fossoyeur est encore dedans, et on le voit qui s’enfonce, puis qui reparaît, régulièrement, à chaque pelletée de terre.
Une simple haie entoure le cimetière. Des ronces ont poussé, où les gamins viennent, les soirs de septembre, manger des mûres. C’est un jardin en rase campagne. Au fond, il y a des groseilliers énormes; un poirier, dans un coin, a grandi comme un chêne ; une courte allée de tilleuls, au milieu, fait un ombrage, sous lequel les vieux en été fument leur pipe. Le soleil brûle, des sauterelles s’effarent, des mouches d’or ronflent dans le frisson de la chaleur. Le silence est tout frémissant de vie, la sève de cette terre grasse coule avec le sang rouge des coquelicots.
On a posé le cercueil près du trou. Le gamin qui porte la croix vient la planter aux pieds du mort, pendant que le prêtre, debout à la tête, continue de lire du latin dans son livre. Mais les assistants s’intéressent surtout au travail du fossoyeur. Ils entourent la fosse, suivent la pelle des yeux ; et, quand ils se retournent, le curé s’en est allé avec les deux enfants; il n’y a plus là que la famille, qui attend d’un air de patience.
Enfin, la fosse est creusée.
— C’est assez profond, va! crie l’un des paysans qui ont porté le corps.
Et tout le monde aide pour descendre le cercueil. Le père Lacour sera bien, dans ce trou. Il connaît la terre, et la terre le connaît. Ils feront bon ménage ensemble. Voici près de soixante ans qu’elle lui a donné ce rendez-vous, le jour où il l’a entamée de son premier coup de pioche. Leurs tendresses devaient finir par là, la terre devait le prendre et le garder. Et quel bon repos! Il entendra seulement les pattes légères des oiseaux plier les brins d’herbe. Personne ne marchera sur sa tête, il restera des années chez lui, sans qu’on le dérange. C’est la mort ensoleillée, le sommeil sans fin dans la paix des campagnes.
Les enfants se sont approchés. Catherine, Antoine, Joseph ramassent une poignée de terre et la jettent sur le vieux. Jacquinet, qui a cueilli des coquelicots, jette aussi son bouquet. Puis, la famille rentre manger la soupe, les bêtes reviennent des champs, le soleil se couche. Une nuit chaude endort le village.
Emile Zola, Comment on meurt, chapitre V
source : www.leboucher.com votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:08
C'est de la mémoire qui s'épanche dans les souvenirs vivants et les pensées insoumises à l'ordre chronologique, car l'ordre du temps ne connaît ni la méthode ni l'événement, préjugés tenaces de la science, mais il est celui du sens, c'est-à-dire de l'existence. C'est dans le présent que la mémoire trouve son élément, par l'introspection et la décomposition minutieuse, qui découvre l'absence et l'irréalité de son être, car le présent n'existe pas, n'étant que l'énonciation directe de la chose qui se passe, et passant, est déjà passée et donc du passé.
Dans la langue que je parle (1), il n'y a pas de temps présent pour le verbe être ; pour dire "je suis", il faut employer un futur ou un passé et, pour commencer mon histoire dans votre langue, je voudrais pouvoir traduire un passé absolu, non un passé composé, qui, dans sa traîtrise, rend présent le passé en mêlant les deux temps. Et je préfère le passé simple qui est simplement révolu dans son unicité et sa belle totalité autant que dans ses sonorités fermées. C'est le vrai passé du temps passé. Le présent qui s'analyse, comme le présent qui s'énonce dans le passé, s'éconduit vers lui comme s'il découvrait sa condition, car le passé est bien la condition de toute chose. Dans la Bible que je lis, il n'y a pas de présent, et le futur et le passé presque identiques. En un sens, le passé s'exprime à travers le futur. On dit que, pour former un temps passé, on ajoute une lettre, vav, au temps futur. On l'appelle le "vav conversif". Mais cette lettre signifie aussi "et". Ainsi, pour lire un verbe conjugué, on a le choix entre, par exemple, "il fit" ou "et il fera". J'ai toujours pris la deuxième solution. Je crois que la Bible ne s'exprime qu'au futur, et qu'elle ne fait jamais qu'énoncer des événements qui n'eurent point lieu, mais qui se produiront dans les temps prochains. Car il n'y a pas de présent, et le passé est le futur.
(1) Il s'agit de l'hébreu : on laisse un vide pour exprimer le présent du verbe être : "ani David - אני דוד" veut dire "je (ani=je) [suis] David". On a le même phénomène en russe.Eliette Abécassis, Qumran, p.18-19
Le Livre de Poche, Paris, 1996 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 3 Février 2010 à 14:02
La matière n'existe pas, puisque tous les peuples ne sont pas d'accord pour nommer les choses. Voici quelques exemples frappant pris dans les langues :
- les chiffres :
- le zéro n'existait pas pour les Romains, il est inventé par les Mésopotamiens au IIIe s. av. notre ère, défini par les Indiens au Ve s., emprunté par les Arabes au VIIIe s., et passent ensuite en Occident seulement au XIIe s.
- le nivkh (langue de Sibérie) ont deux mots différents selon qu'on dénombre des hommes ou des animaux : 'men' ou 'mor' veut dire deux, mais l'un s'applique aux hommes et l'autre aux animaux
- le système décimal n'est pas communs à tous : la base dix est très ancienne. Elle découle d'un choix naturel, dicté par le nombre des doigts des deux mains : 10+10=20 donc deux mains, etc. ; en français, on utilise même deux systèmes à la fois : décimal et vigésimal (sur 20) pour 80 (4x20) (influence des Celtes). Cela se disait huitante ou octante. En Suisse, il reste utilisé sporadiquement. Les Yoruba du Nigéria, entre autres, utilisent encore un système quinaire, à base 5. Le système des chiffres romains utilise une sous-base quinaire, (V, L, D) superposée sur une base décimale. Dans de nombreux langages européens, tels l'anglais, le français et l'allemand, l'usage de noms spéciaux pour 11 et 12 plutôt que leur nom représenté par le système décimal (douze, twelve, zwölf) peut faciliter le comptage en base 12. Il est beaucoup utilisé dans le commerce (douzaine, grosse, etc.). Certaines population (Moyen-Orient, principalement) connaissent ce système de longue date en comptant les phalangettes de la main en omettant celles du pouces (qui est utilisé pour compter les phalangettes des autres doigts). Ce qui donne bien le chiffre douze base de cette numération.
- tous les peuples n'utilisent pas le même signe pour noter les chiffres : 1 s'écrit — en chinois et japonais (pour ne prendre que cette exemple).
- Dans Assignment in Utopia de Eugene Lyons, un chapitre est intitulé « 2 + 2 = 5 » : slogan utilisé par le gouvernement de Staline pour annoncer que le plan quinquennal serait accompli sur une période de quatre ans, et qui fut pendant un moment utilisé largement à Moscou.
- les couleurs :
- bien qu'étant l'une des trois couleurs primaires, le bleu a deux équivalents en russe : синий (proche du bleu marine) ou голубой (proche du bleu ciel)
- en irlandais, vert se traduit par 'glas' ou 'uaine'. En breton, 'glas' veut dire bleu.
- en Chine, le blanc symbolise la mort. La mort étant le passage obligé vers un nouveau monde, elle est considérée comme une renaissance, dont le blanc évoque la pureté.
- il existe des noms de couleurs particulier pour la robe des chevaux : la robe « isabelle » consiste en des poils jaunâtres, des crins noirs, une peau noire et des yeux foncés. Le bas des membres, le bout du nez et le bout des oreilles sont noirs. Elle est souvent associée à la présence d'une raie de mulet et de zébrures.
- certaines personnes sont atteintes de daltonisme, la plus fréquente étant la confusion du vert et du rouge. Les autres formes de daltonisme sont nettement plus rares, comme la confusion du bleu et du jaune, la plus rare de toutes étant la déficience totale de la perception des couleurs (achromatopsie), où le sujet ne perçoit que des nuances de gris. La xanthopsie est un trouble de la vision qui donne une teinte jaune uniforme à tous les objets.
- la synesthésie, du grec syn (union) et aesthesis (sensation), est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. Par exemple, dans un type de synesthésie connu sous le nom de synesthésie "graphèmes-couleurs", les lettres de l'alphabet ou nombres peuvent être perçus colorés. Dans un autre type de synesthésie, appelée "synesthésie numérique" (number form synesthesia), les nombres sont automatiquement et systématiquement associés avec des positions dans l'espace. Dans un autre type de synesthésie, appelé synesthésie de personnification ordinale/linguistique, les nombres, jours de la semaine, mois de l'année évoquent des personnalités. Dans d'autres types de synesthésie, la musique et d'autres sons peuvent être perçus colorés, ou ayant une forme particulière.
- les lettres :
- les Chinois et les Japonais ne connaissent pas le l ou le r, ils prononcent l'un pour l'autre et l'autre pour l'un indifféremment.
- le malgache et le turc s'écrivaient d'abord en lettre arabe, puis en lettre latine. De même, le moldave est retourné à l'alphabet latin, alors qu'il utilisait l'alphabet cyrillique pendant la période soviétique. De même le mongole, qui s'écrit dans son alphabet traditionnel, qui s'écrit de gauche à droite en colonne verticale, s'est écrit en arabe, puis en caractère cyrillique. Le chinois peut s'écrire en caractères latins appelé le pinyin.
- un dictionnaire chinois ne peut suivre l'ordre alphabétique : L'ordre de classement dans un dictionnaire de sinogrammes utilise : un classement primaire selon les « clefs » qui entrent dans la composition des sinogrammes et sont en nombre suffisamment limité — il existe une centaine de clefs courantes — pour se voir fixer un ordre de classement arbitraire ; un classement secondaire par nombre de traits composant le sinogramme.
- la lettre W est entrée officielle dans le dictionnaire suédois qu'en 2006 : peu utilisé en suédois et souvent dans des mots empruntés à des langues étrangères, il partageait jusque-là la section dévolue au V, dont la prononciation est identique. Par contre les ch et ll espagnols ne possèdent plus, depuis 1994, leur propre entrée dans le classement alphabétique. Les accents ne jouent pas de rôle dans le classement des mots en français (pour e par exemple l'ordre alphabétique est : e é è ê ë ; pour la ligature œ (ou e dans l'o) est à considérer en français comme un o suivi d'un e (deux caractères) pour le classement alphabétique) ou en allemand, mais c'est différent en suédois (l'alphabet se termine par V, X, Y, Z, Å, Ä et Ö), danois, norvégien (l'alphabet se termine par Z, Æ, Ø et Å). En hongrois, les lettres Ö et Ü sont classées respectivement après O et U. Les voyelles longues Á, É, Í, Ó, Ú, Ő, Ű sont traitées avec leurs contreparties brèves A, E, I, O, U, Ö, Ü. Le gallois classe ainsi les mots suivants : lawr, lwcus, llong, llom, llongyfarch. Ll et ng étant considéré comme des lettres uniques, comme ch, dd, ff, ph et th. En néerlandais, la combinaison « IJ » était précédemment soit considérée comme « Y », soit classée après celle-ci, mais est à l'heure actuelle le plus souvent classées entre « II » et « IK », sauf pour les noms propres. etc. etc. etc.
- l'odrre des ltteers dnas un mot n'a pas d'ipmrotncae, ce qui cmptoe, c'est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae.
- les mots et les choses :
- il existe un jeu en Allemagne qui consiste à demander au gens d'inventer un mot qui n'existe pas dans la langue : il y a donc des choses qui n'ont pas de nom, par exemple en français, la "chose" qui permet de séparer ses commissions de celle du client suivant au supermarché. Mais il y a aussi des choses qui ont plusieurs noms : tuberculeux / phtisique, sardonique / sarcastique.
- de nombreux proverbes semblent logiques en français et ne peuvent correspondre à rien pour un Japonais ou un russe par exemple.
- quand il est une heure ici, il est deux heures ailleurs, et encore ça dépend de l'heure d'hiver qui n'est pas appliquée partout. votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
-
Par antoiniste le 28 Janvier 2010 à 12:35
D'ailleurs il n'est rien de grand sur cette terre, dans aucun domaine, sans une part de monotonie et d'ennui. Il y a plus de monotonie dans une messe en chant grégorien ou dans un concerto de Bach que dans une opérette. Ce monde où nous sommes tombés existe réellement ; nous sommes réellement chair ; nous avons été jetés hors de l'éternité ; et nous devons réellement traverser le temps, avec peine, minute après minute. Cette peine est notre partage, et la monotonie du travail en est seulement une forme. Mais il n'est pas moins vrai que notre pensée est faite pour dominer le temps, et que cette vocation doit être préservée intacte en tout être humain. La succession absolument uniforme en même temps que variée et continuellement surprenante des jours, des mois, des saisons et des années convient exactement à notre peine et à notre grandeur. Tout ce qui parmi les choses humaines est à quelque degré beau et bon reproduit à quelque degré ce mélange d'uniformité et de variété ; tout ce qui en diffère est mauvais et dégradant.
Simone Weil, La condition ouvrière, p.213
source : classiques.uqac.ca votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 28 Janvier 2010 à 12:26
Janvier a été dur. Pas de travail, pas de pain et pas de feu à la maison. Les Morisseau ont crevé la misère. La femme est blanchisseuse, le mari est maçon. Ils habitent aux Batignolles, rue Cardinet, dans une maison noire, qui empoisonne le quartier. Leur chambre, au cinquième, est si délabrée, que la pluie entre par les fentes du plafond. Encore ne se plaindraient-ils pas, si leur petit Charlot, un gamin de dix ans, n’avait besoin d’une bonne nourriture pour devenir un homme.
L’enfant est chétif, un rien le met sur le flanc. Lorsqu’il allait à l’école, s’il s’appliquait en voulant tout apprendre d’un coup, il revenait malade. Avec ça, très intelligent, un crapaud trop gentil,
qui a une conversation au-dessus de son âge. Les jours où ils n’ont pas de pain à lui donner, les parents pleurent comme des bêtes. D’autant plus que les enfants meurent ainsi que des mouches du haut en bas de la maison, tant c’est malsain.
On casse la glace dans les rues. Même le père a pu se faire embaucher ; il déblaie les ruisseaux à coups de pioche, et le soir il rapporte quarante sous. En attendant que la bâtisse reprenne, c’est toujours de quoi ne pas mourir de faim.
Mais, un jour, l’homme en rentrant trouve Charlot couché. La mère ne sait ce qu’il a. Elle l’avait envoyé à Courcelles, chez sa tante, qui est fripière, voir s’il ne trouverait pas une veste plus chaude que sa blouse de toile, dans laquelle il grelotte. Sa tante n’avait que de vieux paletots d’homme trop larges, et le petit est rentré tout frissonnant, l’air ivre, comme s’il avait bu. Maintenant, il est très rouge sur l’oreiller, il dit des bêtises, il croit qu’il joue aux billes et il chante des chansons.
La mère a pendu un lambeau de châle devant la fenêtre, pour boucher un carreau cassé; en haut, il ne reste que deux vitres libres, qui laissent pénétrer le gris livide du ciel. La misère a vidé la commode, tout le linge est au Mont-de-Piété. Un soir, on a vendu une table et deux chaises. Charlot couchait par terre ; mais, depuis qu’il est malade, on lui a donné le lit, et encore y est-il très mal, car on a porté poignée à poignée la laine du matelas chez une brocanteuse, des demi-livres à la fois, pour quatre ou cinq sous. À cette heure, ce sont le père et la mère qui couchent dans un coin, sur une paillasse dont les chiens ne voudraient pas.
Cependant, tous deux regardent Charlot sauter dans le lit. Qu’a-t-il donc, ce mioche, à battre la campagne ? Peut-être bien qu’une bête l’a mordu ou qu’on lui a fait boire quelque chose de mauvais. Une voisine, Mme Bonnet, est entrée; et, après avoir flairé le petit, elle prétend que c’est un froid et chaud. Elle s’y connaît, elle a perdu son mari dans une maladie pareille.
La mère pleure en serrant Charlot entre ses bras. Le père sort comme un fou et court chercher un médecin. Il en ramène un, très grand, l’air pincé, qui écoute dans le dos de l’enfant, lui tape sur la poitrine, sans dire une parole. Puis, il faut que Mme Bonnet aille prendre chez elle un crayon et du papier, pour qu’il puisse écrire son ordonnance. Quand il se retire, toujours muet, la mère l’interroge d’une voix étranglée :
— Qu’est-ce que c’est, monsieur ?
— Une pleurésie, répond-il d’un ton bref, sans explication.
Puis, il demande à son tour :
— Êtes-vous inscrits au bureau de bienfaisance ?
— Non, monsieur… Nous étions à notre aise, l’été dernier. C’est l’hiver qui nous a tués.
— Tant pis ! tant pis !
Et il promet de revenir. Mme Bonnet prête vingt sous pour aller chez le pharmacien. Avec les quarante sous de Morisseau, on a acheté deux livres de boeuf, du charbon de terre et de la chandelle. Cette première nuit se passe bien. On entretient le feu. Le malade, comme endormi par la grosse chaleur, ne cause plus. Ses petites mains brûlent. En le voyant écrasé sous la fièvre, les parents se tranquillisent; et, le lendemain, ils restent hébétés, repris d’épouvante, lorsque le médecin hoche la tête devant le lit, avec la grimace d’un homme qui n’a plus d’espoir.
Pendant cinq jours, aucun changement ne se produit. Charlot dort, assommé sur l’oreiller. Dans la chambre, la misère qui souffle plus fort, semble entrer avec le vent, par les trous de la toiture et de la fenêtre. Le deuxième soir, on a vendu la dernière chemise de la mère; le troisième, il a fallu retirer encore des poignées de laine, sous le malade, pour payer le pharmacien. Puis, tout a manqué, il n’y a plus rien eu.
Morisseau casse toujours la glace; seulement, ses quarante sous ne suffisent pas. Comme ce froid rigoureux peut tuer Charlot, il souhaite le dégel, tout en le redoutant. Quand il part au travail, il est heureux de voir les rues blanches; puis, il songe au petit qui agonise là-haut, et il demande ardemment un rayon de soleil, une tiédeur de printemps balayant la neige. S’ils étaient seulement inscrits au bureau de bienfaisance, ils auraient le médecin et les remèdes pour rien. La mère s’est présentée à la mairie, mais on lui a répondu que les demandes étaient trop nombreuses, qu’elle devait attendre. Pourtant, elle a obtenu quelques bons de pain ; une dame charitable lui a donné cinq francs. Ensuite, la misère a recommencé.
Le cinquième jour, Morisseau apporte sa dernière pièce de quarante sous. Le dégel est venu, on l’a remercié. Alors, c’est la fin de tout : le poêle reste froid, le pain manque, on ne descend plus les ordonnances chez le pharmacien. Dans la chambre ruisselante d’humidité, le père et la mère grelottent, en face du petit qui râle. Mme Bonnet n’entre plus les voir, parce qu’elle est sensible et que ça lui fait trop de peine. Les gens de la maison passent vite devant leur porte. Par moments, la mère, prise d’une crise de larmes, se jette sur le lit, embrasse l’enfant, comme pour le soulager et le guérir. Le père, imbécile, reste des heures devant la fenêtre, soulevant le vieux châle, regardant le dégel ruisseler, l’eau tomber des toits, à grosses gouttes, et noircir la rue. Peut-être ça fait-il du bien à Charlot.
Un matin, le médecin déclare qu’il ne reviendra pas. L’enfant est perdu.
— C’est ce temps humide qui l’a achevé, dit-il.
Morisseau montre le poing au ciel. Tous les temps font donc crever le pauvre monde ! Il gelait, et cela ne valait rien; il dégèle, et cela est pis encore. Si la femme voulait, ils allumeraient un boisseau de charbon, ils s’en iraient tous les trois ensemble. Ce serait plus vite fini.
Pourtant, la mère est retournée à la mairie ; on a promis de leur envoyer des secours, et ils attendent. Quelle affreuse journée ! Un froid noir tombe du plafond; dans un coin, la pluie coule; il faut mettre un seau, pour recevoir les gouttes. Depuis la veille, ils n’ont rien mangé, l’enfant a bu seulement une tasse de tisane, que la concierge a montée. Le père, assis devant la table, la tête dans les mains, demeure stupide, les oreilles bourdonnantes. À chaque bruit de pas, la mère court à la porte, croit que ce sont enfin les secours promis. Six heures sonnent, rien n’est venu. Le crépuscule est boueux, lent et sinistre comme une agonie.
Brusquement, dans la nuit qui augmente, Charlot balbutie des paroles entrecoupées :
— Maman… maman…
La mère s’approche, reçoit au visage un souffle fort. Et elle n’entend plus rien ; elle distingue vaguement l’enfant, la tête renversée, le cou raidi. Elle crie, affolée, suppliante :
— De la lumière ! vite, de la lumière !… Mon Charlot, parle-moi!
Il n’y a plus de chandelle. Dans sa hâte, elle frotte des allumettes, les casse entre ses doigts. Puis, de ses mains tremblantes, elle tâte le visage de l’enfant.
— Ah ! mon Dieu ! il est mort !… Dis donc, Morisseau, il est mort !
Le père lève la tête, aveuglé par les ténèbres.
— Eh bien ! que veux-tu ? il est mort… Ça vaut mieux.
Aux sanglots de la mère, Mme Bonnet s’est décidée à paraître avec sa lampe. Alors, comme les deux femmes arrangent proprement Charlot, on frappe : ce sont les secours qui arrivent, dix francs, des bons de pain et de viande. Morisseau rit d’un air imbécile, en disant qu’ils manquent toujours le train, au bureau de bienfaisance.
Et quel pauvre cadavre d’enfant, maigre, léger comme une plume! On aurait couché sur le matelas un moineau tué par la neige et ramassé dans la rue, qu’il ne ferait pas un tas plus petit.
Pourtant, Mme Bonnet, qui est redevenue très obligeante, explique que ça ne ressuscitera pas Charlot, de jeûner à côté de lui. Elle offre d’aller chercher du pain et de la viande, en ajoutant qu’elle rapportera aussi de la chandelle. Ils la laissent faire. Quand elle rentre, elle met la table, sert des saucisses toutes chaudes. Et les Morisseau, affamés, mangent gloutonnement près du mort, dont on aperçoit dans l’ombre la petite figure blanche. Le poêle ronfle, on est très bien. Par moments, les yeux de la mère se mouillent. De grosses larmes tombent sur son pain. Comme Charlot aurait chaud ! comme il mangerait volontiers de la saucisse !
Mme Bonnet veut veiller à toute force. Vers une heure, lorsque Morisseau a fini par s’endormir, la tête posée sur le pied du lit, les deux femmes font du café. Une autre voisine, une couturière de dix-huit ans, est invitée; et elle apporte un fond de bouteille d'eau-de-vie, pour payer quelque chose. Alors, les trois femmes boivent leur café à petits coups, en parlant tout bas, en se contant des histoires de morts extraordinaires; peu à peu, leurs voix s’élèvent, leurs cancans s’élargissent, elles causent de la maison, du quartier, d’un crime qu’on a commis rue Nollet. Et, parfois, la mère se lève, vient regarder Charlot, comme pour s’assurer qu’il n’a pas remué.
La déclaration n’ayant pas été faite le soir, il leur faut garder le petit le lendemain, toute la journée. Ils n’ont qu’une chambre, ils vivent avec Charlot, mangent et dorment avec lui. Par instants, ils l’oublient; puis, quand ils le retrouvent, c’est comme s’ils le perdaient une fois encore.
Enfin, le surlendemain, on apporte la bière, pas plus grande qu’une boîte à joujoux, quatre planches mal rabotées, fournies gratuitement par l’administration, sur le certificat d’indigence. Et, en route! on se rend à l’église en courant. Derrière Charlot, il y a le père avec deux camarades rencontrés en chemin, puis la mère, Mme Bonnet et l’autre voisine, la couturière. Ce monde patauge dans la crotte jusqu’à mi-jambe. Il ne pleut pas, mais le brouillard est si mouillé qu’il trempe les vêtements. À l’église, on expédie la cérémonie. Et la course reprend sur le pavé gras.
Le cimetière est au diable, en dehors des fortifications. On descend l’avenue de Saint-Ouen, on passe la barrière, enfin on arrive. C’est un vaste enclos, un terrain vague, fermé de murailles blanches. Des herbes y poussent, la terre remuée fait des bosses, tandis qu’au fond il y a une rangée d’arbres maigres, salissant le ciel de leurs branches noires.
Lentement, le convoi avance dans la terre molle. Maintenant, il pleut; et il faut attendre sous l’averse un vieux prêtre, qui se décide à sortir d’une petite chapelle. Charlot va dormir au fond de la fosse commune. Le champ est semé de croix renversées par le vent, de couronnes pourries par la pluie, un champ de misère et de deuil, dévasté, piétiné, suant cet encombrement de cadavres qu’entassent la faim et le froid des faubourgs.
C’est fini. La terre coule, Charlot est au fond du trou, et les parents s’en vont, sans avoir pu s’agenouiller, dans la boue liquide où ils enfoncent. Dehors, comme il pleut toujours, Morisseau, qui a encore trois francs sur les dix francs du bureau de bienfaisance, invite les camarades et les voisines à prendre quelque chose, chez un marchand de vin. On s’attable, on boit deux litres, on mange un morceau de fromage de Brie. Puis, les camarades, à leur tour, paient deux autres litres. Quand la société rentre dans Paris, elle est très gaie.
Emile Zola, Comment on meurt, chapitre IV
source : www.leboucher.com votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 28 Janvier 2010 à 12:25
Un mot, un regard, un sourire, un froncement de sourcils, affectaient un autre être, éveillant un accord ou une aversion, et une toile se tissait sans commencement et sans fin, s'étendait à l'extérieur et à l'intérieur aussi entremêlant, nouant, et la vie de chacun était liée à la vie des autres.
Daphné du Maurier, Le Bouc émissaire votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 28 Janvier 2010 à 12:24
La vie peut être plus belle que ne la consentent les hommes. La sagesse n’est pas dans la raison, mais dans l’amour. Ah ! j’ai vécu trop prudemment jusqu’à ce jour. Il faut être sans lois pour écouter la loi nouvelle. Ô délivrance ! Ô liberté ! Jusqu’où mon désir peut s’étendre, là j’irai. Ô toi que j’aime, viens avec moi ; je te porterai jusque-là ; que tu puisses plus loin encore.
André Gide, Nouvelles nourritures terrestres (1935), p.10
source : www.ebooksgratuits.com votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 28 Janvier 2010 à 11:31
 N'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?
N'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?הֲלוֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנוּ, הֲלוֹא אֵל אֶחָד בְּרָאָנוּ
(Malachie 2:10, sur la synagogue de Liège)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 15 Janvier 2010 à 18:47
Que faire d'un homme qui hait les papillonnements de l'intellect autour du mystère humain ? Et qui clame fort qu'il faudrait savoir aborder aujourd'hui notre destin avec un grand luxe de préscience sauvage, portée par les voix rauques de la vie antérieure ? Voilà pourquoi je suis un fanatique d'un genre si particulier, solitaire, sans Eglise, sans autre foi que cette foi noire pour les mots qui, de phrase en phrase, m'éloignent de l'esprit du temps. Etre fanatique, dans ce sens-là, c'est se purifier sans cesse des encrassements temporels : l'information pléthorique, enflure politique et publicitaire, le martèlement des exhortations au confort et à la consommation. C'est faire en soi une place inexpugnable au feu essentiel dévorant au-dedans, incendiaire au-dehors, un embrasement contre l'esprit du temps. Mais ce n'est pas assez : l'esprit du temps doit être torturé au moyen d'instruments doués de conscience, de lucidité, aux mains de bourreaux doués de supra-conscience, de supra-lucidité. L'esprit du temps devrait être livré livide à des races qui ne connaissent point la pitié, remontées on ne sait comment, par quel miracle de renversement des valeurs, du fond des abîmes de l'humanité et se conduisant comme des hordes.
Marcel Moreau, Monstre, p.226
Luneau Ascot Editeurs, Paris, 1986 votre commentaire
votre commentaire
-
Par antoiniste le 15 Janvier 2010 à 18:44
Il n'est pas beau, mon cheval. Il a trop de noeuds et de salières, les côtes plates, une queue de rat et des incisives d'Anglaise. Mais il m'attendrit. Je n'en revient pas qu'il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner.
Chaque fois que je l'attelle, je m'attends qu'il me dise : non, d'un signe brusque, et détale.
Point. Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d'aplomb recule avec docilité entre les brancards.
Aussi je ne lui ménage ni l'avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu'à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre. Je le flatte de la main et de la voix. J'éponge ses yeux, je cire ses pieds.
Est-ce que ça le touche ?
On ne sait pas.
Il pète.
C'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabot quelque part.
Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié.
Est-ce qu'il ne va pas bientôt se réveiller de son demi-sommeil, et, prenant d'autorité ma place, me réduire à la sienne ?
A quoi pense-t-il ?
Il pète, pète, pète.
Jules Renard, Histoires naturelles, p.34-35
Le Livre de Poche, Collection Libretti, Paris, 1995 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
sur les traces d'un homme d'exception et de son universalisme philosophique...............Musée virtuel de l'Antoinisme